SAMEDI
18 novembre 2023
de 14h00 à 19h00
dans le cadre du Nouveau cycle
"Techniques fécondes, tonique faconde"
Animation : Régis MOULU
Thème : Montrer, ne pas dire... et surtout faire ressentir
Dire, trop dire, trop expliquer, pire "psychologiser", sont souvent les ennemis de nos textes à écrire. Y a-t-il dès lors encore un peu de place pour le lecteur, pour son imagination, pour sa réflexion ? Aussi, à la place, il est plus stimulant de lui proposer, par exemple, de ressentir. Cette capacité à s'immerger dans le présent sensible permet de tout partager en temps réel. Aussi vue, ouïe, odorat, goût et toucher sont sollicités. Et c'est ce programme fou que nous avons vécu et expérimenté, possiblement avec le cœur à découvert.
Remarque : au-delà de la contrainte formelle (thème), le sujet suivant a été énoncé en début de séance : écrire une histoire dont le protagoniste principal sera en prise à une vie émotionnelle intense (au moins intérieure). Par ailleurs, cette histoire devra comporter les 10 mots suivants : bagne - guêpe - hérissé - jaune - museau - nœud - orchestre - phare - ramasser - tableau
.
 Pour stimuler et renforcer l'écriture et les idées
de chacun, un support développant notamment les procédés pour intensifier les émotions, l'étude des couches de l'empathie et le style célinien a été distribué en ouverture de session.
Pour stimuler et renforcer l'écriture et les idées
de chacun, un support développant notamment les procédés pour intensifier les émotions, l'étude des couches de l'empathie et le style célinien a été distribué en ouverture de session.


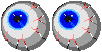


- "Le tableau de Ricardo Mollento" de Régis MOULU
- "Hortense, la nuit" de Nadine CHEVALLIER (écriture en différé)
"Le tableau de Ricardo Mollento" de Régis MOULU, animateur de l'atelier
Je suis dans un musée.
Je m'appelle Anita, j'ai 36 ans.
Peut-être moins parce que je suis idiote.
Ici, le volume de ses salles immenses
m'impressionne.
Je me sens égarée.
Et petite.
Il y a comme un chiffon dans mon cœur.
Je suis surtout venue voir
la toile de Ricardo Mollento.
Mais je ne la trouve pas.
Pourtant, j'ai un plan en main.
Je ne comprends rien.
Il y a personne à qui demander.
Même pas un gardien de salle.
C'est étrange.
Sur ma montre, je découvre qu'il est 23h et quelques.
Une peur m'envahit.
Les horloges m'ont donc abandonnée.
Un couteau vient de me trancher
de haut en bas.
Ou plutôt : j'ai un corps aspiré de l'intérieur,
comme un flan racorni
qu'on avait oublié dans le frigo.
J'aimerais pleurer, mais ça ne sort pas.
Mon sang, c'est une rivière de clous rouillés.
Je vais mal, je me sens mal, j'ai mal, le mal est en moi.
Alors, je souhaite de tout mon cœur
que les extraterrestres m'enlèvent.
Mais ça n'arrive pas.
Ça n'arrivera jamais,
je ne les intéresse pas assez.
Pourtant je me suis bien coiffée ce matin.
Les cheveux, mon seul espace de sophistication.
Comme un terrain d'entraînement
pour mon imagination, ma liberté,
la vie qui tape à mes tympans d'oreille
où balancent de jolis bijoux
en forme de phares de voiture.
Je suis perdue.
Au milieu des vieilles œuvres
qui ont plus d'âme que moi.
Plus de tempérance.
Plus d'idées.
Plus de messages.
Plus de sagesse.
Plus de grandeur.
Beaucoup de hauteur.
Le vertige à partir, pourtant,
de l'équivalent d'un seau de peintures.
Ce peuple m'entoure.
Me juge, agrandi par ses siècles de pavane.
M'écrase en somme.
Je suis décharnée. Plate.
Et je sens mon visage vert olive
vouloir se tourner tout seul.
Il entend faire pivoter tout mon corps
et effectuer un arrêt
en fac e de chaque tableau accroché.
Mais pourquoi ?
C'est une épreuve au-delà de mes forces.
Je ne la désire pas.
Maudite appréhension
qui m'assène un nœud dans la gorge.
Je pense alors à des abricots bien mûrs.
Ça ne suffira pas,
déjà ma chaire se met en branle,
le tableau 1 me magnétise.
Je lis « Goya »,
et c'est tout un bagne qui me devise.
Aux sortilèges, j'y crois.
Cette peinture est une verrue évolutive,
un crachat de sorcière
qui m'atteint.
Je sanglote
des larmes qui demandent pitié.
Je tâte l'endroit où sont les poches de ma robe :
pas de mouchoirs.
Mes pleurs sont calcaires,
je vais finir en fossile,
c'est pour bientôt.
Je me sens surtout dévastée.
Réduite à rien.
Une chose posée
qu'un courant d'air ramassera.
Le jacquemart qu'est ma personne
se remet en branle,
marque un arrêt sur la toile 2.
Une jeune fille mange une pomme
dont le pourri sur sa face cachée
attire une guêpe.
Ça m'insupporte.
Je crie malgré moi.
Un aigu très coupant.
Les poils des banquettes
se retrouvent tout hérissés.
Je ferme les yeux
pour ne pas exploser.
Une alarme retentit.
Le son me fracasse.
Je suis un éboulis,
un éboulis qui repivote.
Toile 3 : un orchestre
plongé dans la pénombre
installe son hypnotique mélodie,
chaque musicien est vêtu d'un drapé
qui ajoute des ondes
à la romance distillée.
C'est en fait un lasso
qui m'enserre le cerveau
avec la volonté de le déloger de sa boîte,
on appelle cela, aussi, « un mal de tête ».
Les musées sont des lieux de torture,
de violence qu'on croit, à première vue,
plate,
un parcours d'épreuves,
une succession de morts,
je suis l'objet de mon décès
qui ne cesse de ressusciter.
Ma silhouette s'est envolée.
D'habitude la peau nous sert à savoir
jusqu'où l'on existe,
moi je n'ai plus ce repère.
Dissoute, je me retrouve dissoute
et pourtant comme orientée malgré moi
sur le tableau 4.
Le bœuf écorché de Rembrandt
semble alors être mon frère.
Déjà, tout ce qui faisait de lui
un animal honorable, recevable et apprécié
a disparu :
museau, sabots, toupillon :
toute sa majesté
qui relève du détail.
Ici, tout est boucherie, calme et atrocité.
Je me sens si proche de lui
que monte en moi
une compassion qui finalement
me siphonne de ma vitalité.
Comment est-ce possible
qu'on ferme un musée
sans vérifier que tous les visiteurs en soient sortis ?
Je suis « jaune contrariété ».
Meurtrie comme le sont
des fruits dans une centrifugeuse
qu'on oublie d'arrêter.
J'ai 90 ans
et je vais m'évanouir.
On me retrouvera,
on me regroupera,
on me transportera à l'hôpital,
on me réveillera,
on cherchera à me rassurer,
on me demandera de libérer ma chambre,
on m'oubliera
et personne ne m'empêchera de revenir demain
au musée
chercher sans le trouver
le tableau de Ricardo Mollento
intitulé « La transfiguration de l'âme ».
"Hortense, la nuit" de Nadine CHEVALLIER, texte écrit hors séance, dans les mêmes conditions
Je me suis couchée tôt ce soir, encore plus tôt que d’habitude, il devait être 8 heures, guère plus.
Trop fatiguée pour rester à veiller. Lire ? Tricoter ? Regarder la télé ? Toutes ces choses que font les gens le soir après dîner ? Trop fatiguée. Alors me voici dans ce lit. Des pensées insensées tournent en rond dans mon vieux cerveau. Pourquoi si fatiguée que je sois, je ne puis m’endormir tranquillement ?
Et peut-être ne plus me réveiller ?
Mon épaule droite me fait mal comme si une guêpe l’avait piquée, je ne peux me tourner de ce côté, je la déplace doucement d’avant en arrière mais la douleur palpite, j’essaie de l’occulter, de penser à autre chose. Il faut respirer profondément parait-il, facile à dire !
Comme un chien qui a couru, je halète, mon cœur bat trop vite, il va sortir de ma poitrine, il cogne contre mes côtes. Toutes les percussions du grand orchestre frappent en même temps, je n’ose plus bouger, toute à l’écoute de ces coups sourds qui résonnent jusque dans ma tête. Puis brusquement tout s’arrête, mon cœur a-t-il cessé de battre ? Je ne le sens plus, vais-je mourir à cet instant ?
Un nœud me serre la poitrine. Mes mains se crispent sur la couverture, je sens les plis du tissu sous mes doigts. J’ouvre les yeux sur le noir de la chambre, je distingue un rai jaune pâle sous le volet roulant, une porte claque chez les voisins, je vois et j’entends, ma main gauche a pris mon poignet droit, je perçois le sang qui pulse sous mon pouce, je ne meurs pas encore.
Combien de temps a passé, je ne sais, quand cette nuit finira-t-elle ? Les battements du cœur, le souffle, tout ça fonctionne automatiquement, on n’a pas à s’en occuper, ça me paraît en même temps si extraordinaire et si inquiétant. Je n’ai pas peur de la mort, enfin c’est ce que je dis, ce que je crois, mais l’idée de mourir comme ça en pleine nuit, toute seule, c’est …
Mon souffle est court, peut-être devrais-je dormir assise, mais mon lit n’est pas adapté. C’est le lit que j’ai depuis des années, celui où j’ai veillé chaque nuit mon mari pendant sa maladie. C’est pour ça que j’ai perdu le sommeil, être à l’affût de tous ses mouvements pendant des mois, prête à tout pour l’aider, guetter son souffle, dans la crainte du dernier. Et maintenant me voilà toute seule, tous ces efforts inutiles, toutes ces heures passées pour cet homme qui ne m’a jamais remerciée. Ce n’était pas le bagne mais enfin, j’espérais une vie plus joyeuse. Le beau militaire rencontré au jardin des Plantes s’est révélé un égoïste de première catégorie. Ah si ! A la fin, alors qu’il remerciait tant les infirmières, il a reconnu qu’il n‘aurait pas vécu si bien sans moi, un merci bien tardif, piètre consolation.
Je suis contrariée que mes pensées m’entraînent dans ces souvenirs moroses. Le sommeil ne va pas venir comme ça.
Et voilà que j’ai envie de faire pipi à présent.
Me tournant avec peine, j’allume la petite lampe de chevet. Je descends mes jambes lourdes au bord du lit, me tourne avec lenteur, j’ai du mal à m’appuyer sur mon bras droit pour me relever. Me voilà debout,
quelques pas, pieds nus sur le carrelage glacé, de quoi hérisser les poils, je frissonne dans ma chemise de nuit trop courte, j’attrape ma robe de chambre et la pose sur mes épaules.
Les toilettes me semblent loin cette nuit, je dois traverser le séjour. Je passe devant le tableau où j’ai affiché toutes les photos des jours heureux. Cet appartement ne m’a jamais plu. Comme je regrette ma maison, celle où j’ai élevé mes enfants, où j’invitais tous mes amis... Je pense à elle comme à un havre de bonheur maintenant que je suis ici, dans cette ville que je ne connais pas. C’est mon fils qui a choisi, je n’ai pas eu mon mot à dire. Quand on est vieux, ça redevient comme quand on est tout petit, les autres décident pour vous. Il a fait pour le mieux j’imagine, il faut dire qu’il n’y avait pas grand choix de logement pour une personne seule.
Il faut que j’arrête de ruminer.
Je fais pipi, me rince les mains au petit lavabo, l’eau est froide, le miroir me renvoie le reflet de mon museau fripé. Je ne veux pas me voir. Je me penche en ahanant et ramasse ma robe de chambre tombée à terre. Le souffle court, me voici sur le chemin du retour. Comme un phare au bout du couloir, la lampe allumée dans la chambre me guide, je me tiens aux murs en vacillant. Mes pieds nus sont devenus insensibles, comme anesthésiés par le froid. Je marche comme un robot.
Nouvel effort pour me recoucher, mes mouvements sont d’une lenteur désespérante, moi qui étais si vive autrefois, j’ai l’impression de tout faire au ralenti. J’avale l’air par petites lampées précipitées, mon cœur palpite de nouveau trop fort, trop vite. Je m’affale en travers du lit, renonçant à tout, j’attends que la crise passe. Après une éternité, gardant ma robe de chambre, je réussis à me coucher dans le bon sens. Je m’enfouis sous la couverture, je grelotte.
Et la nuit dure et perdure. Je perds parfois conscience dans de brefs instants de sommeil agité.
Le temps s’étire en accordéon jusqu’au matin.
Je ne suis pas morte cette nuit.