SAMEDI
14 Juin 2014
de 14h00 à 19h00
dans le cadre du cycle
"J'écris comme d'autres peignent"
Animation : Régis MOULU
Thème : Ne pas produire le visible, rendre visible (Klee)
Au cours de cette séance, il s'agira de charger son écrit d'une dynamique entretenue, cela consiste à multiplier les niveaux logiques et à rédiger comme pour un script de cinéma (suggestion).
Remarque
: au-delà de la contrainte formelle
(thème), le sujet suivant a été énoncé en début de séance, à savoir : écrire un texte contenant, sous quelque forme que ce soit, les quatre éléments suivants : un(e) muet(te) ou un groupe de muets (personnage), un centre commercial (lieu), 19 h (le moment), et une fouine (objet de curiosité).
 Pour stimuler et renforcer l'écriture et les idées
de chacun, un support a été distribué en début de séance... A tribute to the sérénissime attitude !
Pour stimuler et renforcer l'écriture et les idées
de chacun, un support a été distribué en début de séance... A tribute to the sérénissime attitude !

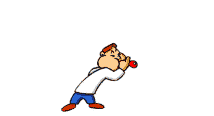
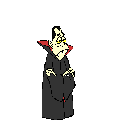
![]()
Ci-après
quelques textes produits durant la séance, notamment (dans l'ordre):
- "Cette rencontre" de Cécile BELLAN
- "Le silence de Jason" d'Ella KOZèS
- "Adelaïde" de Janine NOWAK
- "on ne voit bien qu'avec l'abstraction visible" de Marie-Odile GUIGNON
- "La dernière heure" de Philippa LAUNAY
"Cette rencontre" de Cécile BELLAN
Rouge à lèvre je pose, trace parfumé, il est 19h00. La nuit est tombée, l’hiver s’annonce. Je cours. Un peu barbouillée, les gouttes de pluie glissent lentement le long de ma veste. Le métro est bondé. Mon sac en cuir rouge, parapluie fermé. Rangée de fauteuils, marrons tout en crasse, sueurs mêlées. S’asseoir et ne plus penser.
Lecture….page des faits divers, les yeux sont rivés, le journal ouvert, mains toujours crispées. mon voisin a l’air tellement fatigué.
Rouge à points dorés, jaune ou émeraude, la dame descend, me regarde en biais : l’ai-je bien déposé ce rouge nacré sur mes lèvres fébriles ? Sa robe est étrange. Voudra-t’il venir ?
Gris désolation, couloirs étriqués, déambulation de centaines de pieds. Je voudrais passer. La correspondance, attente toujours, en suspend mon rêve de pouvoir t’aimer.
Arrêt St Lazare, te rejoindre vite par la rue Icare, la pluie est battante. Rafraîchit encore mes idées mirages. Douceur du temps. Mon cœur écrasé, sera-t-il présent ? Le bruit de la pluie vient m’accompagner. Clapotis léger dans ma tête danse. Quelle drôle d’idée ce centre commercial pour se retrouver.
Enfin, il est là…..c’est bien lui, je vois….cheveux gris frisés, un brin emmêlés…Caissières énervées, fait un signe de tête. Ma main se projette, il m’a regardée, sourires complices. Se faufile soudain à travers la foule, se donner la main. Nos yeux se disent tout. Le silence est d’or quand les cœurs se parlent. Nature divine, nous nous comprenons. Langage atténué, signes exagérés. Notre monde est blanc.
Partir en vitesse, pouvoir s’isoler, partager l’ivresse. Le centre est derrière : allées comprimées, objets entassés, couleurs bariolées…nous n’emmènerons rien.
« CADEAU » c’est écrit dessus, écriture serrée, plume noire ciselée, petit mot glissé dans ma main tremblante. Surprise dans nos yeux, soleil sur nos lèvres. Qu’ai-je donc mérité ?
Une photo marrante, un peu décalée : elle part à la chasse, petites pâtes agiles aux griffes si fines. Je t’ai reconnu petite fouine coquine car comme nous deux, tu as dans les yeux cet air malicieux pour décrire le monde à défaut de pouvoir le dire.
"Le silence de Jason" d'Ella KOZèS
Vue d’hélico la campagne déroule ses rectangles colorés d’avant les moissons, roulement de tambour, tempête d’herbes folles en vagues à l’atterrissage, ballet de poussières lorsque Jason jaillit de l’avion comme un dieu casqué de kaki, terre mêlée de feuillages d’hiver moulant son corps d’athlète sous un manteau d’automne humide et gris. Son pas assuré ébranle les fondements d’une vie étriquée, son souffle brulant rejoint les mirages solaires, pépites de blé chaud, caramel de maïs soufflé dans le bol qui l’attend à la ferme, avec un grand verre de pureté blanche et mousseuse.
La prise de pub terminée, après avoir fourré son fric dans la poche arrière de son pantalon, il s’effiloche prestement avec sa caisse, noircie de vieilles odeurs mêlées de cigarettes, les oreilles pleines à craquer du dernier groupe hurlant le métal dégoulinant d’un son d’acier qui perce ses oreilles de muet.
Tina le suit de son regard collant pour le scotcher sur place, elle se glisse à sa hauteur, le dépasse, le bloque de son corps moite et lui crie toujours les mêmes mots : « Alors, combien ? » Il esquive souplement la tentation qui lui tourne autour en pensant qu’elle ne devrait pas crier ainsi quand elle est si proche de lui, elle devrait savoir qu’il n’est pas sourd. Il lui balance un pauvre sourire en mettant ses mains sur ses oreilles pour limiter les décibels pendant que Tina, énervée débute sa danse du scalp.
C’est toujours pareil, à chaque fois qu’il peut allonger quelques billets, il devient le centre de la vie de Tina l’exubérante, elle le célèbre comme son héros mythique de retour d’une incroyable et dangereuse aventure, elle le pare de toutes les qualités jusqu’à en devenir amoureuse. L’histoire se répète inlassablement de mois en mois, le lit en est le protagoniste central par lequel ils vont passer un trop court moment, les emmène loin de leur quotidien rugueux comme une petite musique de chambre, les propulse dans un avenir serein rythmé d’un dur labeur agricole où défilent les saisons de leurs vies, illustrées d’un Vivaldi distordu par l’écho des montagnes environnantes. Sa longue chevelure noire l’enserre dans ses filets laissant l’assaillant souvenir filtrer dans ses pensées, ce souriceau suspendu mort pendu corde de cheveux autour du petit cou gracile, Tina les yeux hagards au réveil terrorisée par le défunt à peine né.
Tina bloque la porte d’entrée par une chaise, ferme les rideaux de la pièce à vivre pour sortir les économies de leur cachette, elle regarde Jason heureux y additionner son cachet de personnage légendaire, elle se saisit des billets verts qu’elle caresse en psalmodiant jusqu’au plus complet silence qui pèse de tout son poids sur lui, Jason a compris et obtempère : de ses mains de paysan besogneux, il compte allégro les billets un par un et pâlit, elle a peur qu’il se soit trompé et lui demande de recompter. Taiseux par nature, il s’exécute plus andante, blanc comme un linge, puis, alors qu’elle a de plus en plus de mal à conserver son calme, il écrit sur le petit carnet gris la somme finale, elle tremblante comme une feuille prête à se détacher de l’arbre, yeux cernés de courtes périodes de sommeil entrecoupées de combats nocturnes cauchemardesques, déclare solennellement d’une voix grave et forte : « Tremblez petits envahisseurs dégoûtants, tremblez peuple de l’ombre aux yeux rouges, demain soir 19h, nous serons au Centre Commercial de la Vallée, nous irons chez Kenny acheter le premier couple de fouines du domaine de Jason et Tina».
"Adelaïde" de Janine NOWAK
Mon sac sur le dos, je poursuis mon Graal. Ce Graal inaccessible, pour lequel j’ai tout abandonné : travail, maison, Patrie.
Mon sac sur le dos, je parcours l’Europe.
Que de pays visités, déjà ! Belgique, Hollande, Allemagne, Autriche, Suisse.
Parisien d’origine, je ne m’exprime qu’en Français.
Pour vivre, je me débrouille. Mais attention : je ne suis ni voleur, ni mendiant !
Avec ma dégaine de semi-clochard chevelu et barbu et mon air un peu farouche, les gens qui me croisent doivent penser que je n’ai jamais rien connu d’autre que les épines de la vie et que depuis longtemps j’ai cessé de croire aux roses que ces épines parviennent miraculeusement à faire fleurir.
Je suis conscient de la sensation que je produis et m’en amuse pleinement.
Je ne suis pas anarchiste. Je suis plutôt d’un tempérament doux, aimable et paisible.
Et je suis très gai. J’aime plaisanter. Mais comment plaisanter dans une langue que l’on ne parle pas ?
Facile : par geste ! Le langage des sourds-muets, en quelque sorte.
Et justement aujourd’hui, je me sens d’humeur facétieuse. J’ai envie de refaire le « coup de la fouine » !
La nuit est déjà tombée en cette soirée d’automne. Je lis la fatigue sur les visages des caissières de la grande surface de ce centre commercial de la banlieue de Florence. J’ai compris, en examinant la petite affichette, que l’heure de la fermeture est pour 19 h 30. Or, il est déjà 19 heures, et je vois encore beaucoup de gens pénétrer dans ce magasin. Apitoyé, je me dis : « Les pauvres femmes vont devoir faire un temps de travail supplémentaire pour absorber tout ce monde. Alors, à moi de jouer ! ».
A moi et à… Adélaïde !
Adélaïde, c’est ma fouine. Parfaitement.
Voilà comment nous avons fait connaissance elle et moi.
Je venais de passer la nuit, à la belle étoile, dans les Alpes Bavaroises. Au réveil, je vois, pelotonné et endormi au milieu de mes vêtements, un petit animal au pelage brun roussâtre. Je m’approche avec précaution. Sentant ma présence, la petite bête ouvre des yeux étonnés et inquiets, mais ne fait pas mine de fuir. Je verse un peu de lait dans une gamelle, trempe un index dedans et tends ce doigt à la petite fouine (oui, je suis assez bon en zoologie pour savoir reconnaître une fouine dès le premier regard). Une preste langue rose sort du museau allongé, une léchouille, et… la glace était rompue !
Adélaïde et moi, nous ne nous sommes plus jamais quittés.
Certains adoptent des chiens, d’autres des chats, des serpents ou des mygales. Pourquoi pas une fouine après tout ? C’est très affectueux et très intelligent.
Bon, que j’explique ce que j’appelle le « coup de la fouine ».
J’ai souvent remarqué, au cours de mes pérégrinations, que des fâcheux prennent un malin plaisir à venir faire leurs achats à deux doigts de l’heure de la fermeture des boutiques. Pour certains, c’est inévitable : on sort vite vite du travail, puis on court vite vite pour attraper son métro ou un autre transport en commun, dans lequel on passe un temps fort long. Et enfin, vite vite, on court acheter une salade et un bout de jambon pour le repas du soir, que l’on prendra vite vite avant d’aller au lit, épuisé.
Mais, il y a les autres, les redoutables, les femmes au foyer, ces mémères oisives et bavardes, qui palabrent pendant des heures devant les vitrines et qui brusquement prennent conscience que le temps a filé.
Alors voilà : ce sont elles, les victimes d’Adélaïde !
Dans la campagne, dans la nature, ma fouine, je la laisse folâtrer où bon lui semble. Elle me rejoint toujours.
Mais dans les villes, je la porte dans un grand foulard noué autour de ma taille, un peu comme les Africaines avec leurs bébés sur le dos… mais à l’envers ;
Adélaïde est là, sur mon ventre ; je peux la toucher, la caresser, la rassurer, car elle n’aime pas le bruit ; aussi, bien dissimulée dans mon écharpe, se fait-elle toute petite, se rendant tout à fait invisible. Ceux qui me croisent, imaginent probablement que j’ai une grosse bedaine !
Donc, je pénètre dans le magasin, avance calmement dans les allées et brusquement je tire Adélaïde de sa cachette et la colle sous le nez de ces femmes peu soucieuses du travail des autres.
Et croyez-moi, avec ses yeux comme des billes toutes noires, ses dents très pointues et sa longue gueule grande ouverte, une fouine est assez impressionnante.
Du coup, ces inconscientes lâchent tout : leurs poireaux, leurs choux, leurs paquets de nouilles, leurs rouleaux de papier absorbant, leurs boîtes de gâteaux… et courent en hurlant vers la sortie.
Ce petit jeu semble beaucoup distraire Adélaïde !
Bien évidemment, quelques fois, des surveillants n’apprécient pas ma façon de faire. Ils viennent me chercher, me conduisent à l’écart dans un bureau. Je les accompagne toujours très docilement.
On essaie de me parler et de me faire parler. Mais j’ouvre de grands yeux tout ronds, fais un gentil et large sourire, soulève les mains en signe d’impuissance… et me tais. Hé oui, toujours la barrière de la langue qui me rend muet. Et c’est bien commode dans le cas présent : rien à expliquer !
Aussi, fatalement, de guerre lasse, on m’expulse.
Et je reprends ma route, avec mon sac sur le dos et Adélaïde sur le ventre.
Et je suis heureux.
"On ne voit bien qu'avec l'abstraction visible" de Marie-Odile GUIGNON
Aux alentours d'une grandiose masse géométrique s'agglutinent en ordre d'arrivée, des rangées de petits cubes ternes ou colorés. De ces subites immobilités s'extirpent des occupants qui s'engouffrent dans les ouvertures vitrées coulissantes du vaste bâtiment et qui disparaissent, avalés par l'appétit insatiable de cette ruche nommée centre commercial.
La chasse est ouverte, des paquets de faux curieux s'agglutinent dans les artères encombrées de vitrines appétissantes devant lesquelles les cous s'allongent et les sacs se pressent autant que les corps. Les concours à l'étalage regorgent de griffes célèbres qui égratignent les convoitises naissantes des candidats aux achats, les yeux clignotent d'une curiosité en train d'accoucher de ses désirs de consommation.
Les sentiers bordées de boutiques subissent les piétinements incessants des fouineurs à la recherche de mets savoureux. Les papilles excitées, ils pénètrent dans les étalages, palpent de tout frénétiquement, s'extasient enfin devant la chose, s'agrippent aux trophées de leurs trouvailles en écoutant la symphonie de leur satisfaction.
A l'angle d'une bifurcation un personnage somnole, une pancarte en carton en guise de collier se balance devant sa silhouette, les pieds calés dans des chaussures style gueule ouverte, d'un équilibre de monument scellé, le pantalon accordéon, les bras de l'infortune enfilés dans un veston neutre, la mine patibulaire, cheveux et barbe sans âge, il jouit d'un halo d'espace, les vagues humaines contournant l'atmosphère qui émane de ce lieu de rencontre.
Par intermittence il gesticule sans mot dire. - Attirer l'attention – Faire que des regards compatissants osent croiser sa pancarte et qu'un geste secourable réponde à sa subsistance : Le centre commercial à pour vocation de remplir les besaces, que diable !
Mais, les petites pièces se taisent aux fonds des sacs, détrônées par les cartes magnétiques, elles ne sonnent plus, elles dépriment lentement, atteintes d'aphonie elles étouffent écrasées méprisées décimées, elles perdent cours, s'ennuient à mourir, elles rêvent sans espoir d'être exhibées joyeusement pour aller se lover dans dans la sébile d'un marginalisé qui leur ressemble tellement... Entre muets la compréhension agite les cœurs et la moralité s'en ressent.
Il est 19 h : Ballotté par le flux et le reflux de la foule, l’œil de la petite Mélisandre s'était terni jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de la surface découverte, dans le carrefour de l'homme esseulé. Stoppée, elle scrute le carton suspendu sur le buste et subitement ses pupilles se ravivent, ce n'est pas un vulgaire dessin c'est un animal qu'elle contemple avec réjouissance, une petite bête si élégante avec sa tête fine, son regard intelligent, son poil brun soyeux, sa gorge et son ventre blanc, ses pattes défensives aux ongles brillants, sa queue qui s'affine si joliment.
L'animal et Mélisandre échangent des regards complices – elles se connaissent déjà - les lèvres se meuvent de part et d'autres, questions réponses, réinterrogations ré-explications, un dialogue feutré où règne le roi du silence où les faims de connaître sévissent où l'espace malodorant s'envahit des miracles de la curiosité où tout se métamorphose. La légèreté flotte, la beauté irradie, une nouvelle planète se forme dans un lieu insolite.
Le défilement des gens s'amenuise... Mélisandre s'approche doucement… La petite fouine de ses livres animaliers, son amie, sa compagne de chevet, ici bien vivante, saute dans ses bras et l'invite à sortir...
Mélisandre caresse la douce fourrure.
Le reflet de la Lune se glisse entre les pattes de la petite bête...
La nuit est tombée...
Furtivement, la fouine se glisse le long de la haie qui borde la déchetterie du centre commercial...
"La dernière heure" de Philippa LAUNAY (texte écrit en différé, en "off", dans les mêmes conditions)
Il n'y avait AUCUNE raison d'angoisser. C'était toujours la même chose à cette heure. Au dessus, en dessous, la rumeur en écho venait percuter l'intérieur de ma tête, les roues des poussettes les rires le vertige de la dernière heure.
Je savais quelle heure il était, même si aucun repère ne l'indiquait. La coupole au-dessus de l'atrium central était toujours opaque. Mon seul repère, c'était l'ENERGIE de ceux qui passaient devant derrière moi et dans les allées sous l'atrium central. En fermant les yeux, je pouvais dire avec exactitude OÙ nous en étions du jour ou de la nuit. Je percevais les vibrations les mouvements la rage du soir emplis de la colère de la journée. Frustrations au travail, émois d'adolescents, peine de rentrer dans un intérieur triste et sans balcon, l'odeur de la cuisine et les enfants toujours en bas, à traîner. J'écoutais dans leurs pas l'ennui des vies encombrantes et sans couleurs.
Moi, je n'étais pas EUX. Je n'étais pas né AVEUGLE, je n'étais pas SOURD. Je voyais tout, j'absorbais tout. De mon poste en haut de l'escalator, je les voyais mener leur vie d'année en année. Ils accumulaient de la tension chaque année un peu plus en haut de l'escalator à ce point névralgique où j'étais chaque jour depuis quinze ans. Les petits déjà limités par les générations d'avant, devenues des machines. Ici, j'étais au COEUR de la ruche, dans la flamme du temple. Je les observais devenir toujours plus gras et plus bêtes. Plus ils s'anéantissaient sous leur propre poids, plus je devenais vivant, moi le cerbère, le gardien de la porte du temple.
Mais ATTENTION, cela demandait toute ma concentration. Une abnégation totale. Ma vie privée s'était érodée au profit de la seule mission que je remplissais maintenant COMPLETEMENT. Je n'avais plus RIEN de privé. J'avais bien eu ma période où je pensais - INCONSCIENT - que je pouvais choisir ce quotidien promis et tranquille, mener ma petite vie dans un appartement simple mais fonctionnel, là où j'avais appris à grandir à devenir adulte. Mais NON - à ce moment-là - je ne savais pas encore que c'était impossible, je ne savais pas encore que cela ne m'était pas permis.
A cette époque, peut-être il y a une dizaine d'années, je me réveillais au milieu de la nuit, en nage, les tempes prêtes à exploser, ayant accumulé tant de violence pendant mon sommeil que je m'étais mis à avoir peur. J'étais tout entier pris par cette violence et les femmes - RARES - qui partageaient mon lit avaient peur aussi. De toutes façons, je ne savais pas trop quoi faire avec les femmes, la plupart du temps, je leur infligeais des monologues des heures durant, elles m'écoutaient parler du détail d'une démarche que j'avais remarqué un jour ou d'un habitué ou d'une famille dont j'avais compris l'histoire. J'étais devenu incapable de leur proposer de sortir au restaurant ou d'aller faire un tour dans le parc au bord du lac, de peur de ressembler à ceux que j'observais chaque jour de mon poste, en haut de l'escalator, dans l'atrium central. Chaque jour avec un peu plus de mépris. J'avais dû renoncer à inviter des femmes. Ma mission prenait tout mon sang.
En quinze ans de travail ici, j'avais beaucoup maigri. Le soir, seul face à l'assiette, abandonné, les oreilles bourdonnantes de la rage de l'atrium. Je ne savais plus quelle heure il était, je passais des nuits assis - FIXE - essayant de comprendre pourquoi. J'étais échoué seul vivant dans un monde avide qui buvait mon sang.
Je ne nie pas que certains me reconnaissaient, ils n'étaient pas tous des brutes. Mais ceux-là s'adressaient à moi comme si je n'appartenais pas à la même humanité qu'eux. "Où sont les toilettes ?" "Je cherche Carrefour" "Il y a un tabac ici ?" Ils ne comprenaient pas qui j'étais. Une partie d'eux devait bien s'en douter puisqu'ils venaient toujours à moi. Ils venaient toujours à moi me poser des questions. Ils devaient bien savoir que je savais des choses qu'eux ignoraient. Mais leur ton. Leur petit ton aigrelet sur fond de RUGISSEMENT en haut de l'atrium où j'étais chaque jour à mon poste. J'étais le grand maître à bord de l'arche de Noé. Parfois j'imaginais la ville dehors, les rues dévastées par une immense catastrophe. J'imaginais que toute cette énergie ACCUMULEE avait explosé et nous étions seuls, seuls survivants. Et je serais leur guide à tous.
PEUT-ETRE ils me méprisaient. PEUT ETRE ils pensaient que j'étais à leur service. Mais ils se trompaient. Je les voyais, comme aujourd'hui, MAINTENANT à cette heure précise, la plus frénétique, une heure avant 20h, 45 minutes avant l'annonce qui allait les jeter hors du temple. Je me laissais pénétrer par leurs vibrations ma vue se brouillait sous tant de couleurs de mouvements de chaleur. Bientôt les cinquante sept portes allaient s'ouvrir en même temps et ils s'échapperaient, retourneraient à leur insignifiance les bras chargés de sacs en plastique qui les feraient suffoquer un peu plus.
Je connaissais le moindre recoin du centre commercial. J'étais le plus ancien des agents de sécurité. En quinze ans, j'en avais vu des centaines défiler. Quand j'en voyais un nouveau, je savais rien qu'en le regardant dans les yeux combien de temps il tiendrait. Pour DURER ici, il fallait tout supporter. Debout pendant des heures, les insultes, les questions, les regards méprisants, les bagarres, les menaces. En un regard je disais UNE SEMAINE TROIS MOIS DEUX ANS. La plupart venait de la cité d'à côté, des jeunes que j'avais vu grandir de la poussette à la rue. Des abrutis qui pensaient qu'ils étaient solides. Je les voyais ressortir sur les genoux en pleurant.
Il y en avait UN. Un seul. Pas comme les autres. Le muet. Tout le monde l'appelle le muet. C'est vrai qu'en quinze ans, jamais entendu le son de sa voix. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un vrai muet. Je pense qu'il a fini par choisir de plus parler.
Je le vois, au troisième sous-sol où nous avons une petite pièce avec du café et une vieille télé. Il est le seul, le seul avec moi, à venir faire toutes ses pauses dans la petite pièce jaune qui sent le carton et le caoutchouc. Les jeunes vont dehors fumer ils ne supportent pas cet endroit pendant leurs pauses il faut qu'ils sortent. Mais nous, nous descendons, bien en sécurité au cœur du centre commercial dans la petite pièce jaune du troisième sous-sol. Je ne sais pas s'il les entend. MOI OUI. Des fouines. Depuis des années, des fouines qui vivent avec nous dans le sous-sol. Impossible d'éviter ces petits chuintements cette présence obsédante ces petits cris. Je ne sais pas si le muet entend ces bruits, nous faisons comme s'il n'y a RIEN mais j'entends sans arrêt ces petits cris dans le sous-sol. Quand ils deviennent insupportables je jette le gobelet et je remonte en haut de l'escalator dans l'atrium central où il n'y a plus de fouines plus de cris juste une rumeur indéterminée la coupole opaque de jour comme de nuit.
Le muet. Je ne sais pas comment il fait pour supporter les fouines depuis toutes ces années. Lui aussi je sais qu'il stocke la tension du centre commercial et comme moi de temps en temps il faut la rejeter.
Je l'ai vu un soir comme celui-là, au moment de la DERNIERE HEURE, l'heure frénétique, taper comme un sourd sur un mineur qui faisait le malin. Le p'tit avait volé un accessoire de téléphone au Carrefour. Cette fois-là, cette seule fois-là, j'ai vu - JE L'AI VUE - son regard sa colère et je me suis mis à le respecter. Il tenait le petit, peut-être quinze ou seize ans qui était là par terre, immobilisé, les larmes aux yeux, hébété de recevoir les coups du muet. Il suppliait.
Ce soir-là je regardais de loin et je me suis approché. Je suis allé vers le p'tit, je l'ai pris par le col de son pull - il était pauvre - et il avait cette coque de téléphone rose dans la main. Peut-être un cadeau pour sa sœur sa petite amie sa mère. Il n'avait pas l'argent - comment l'aurait-il eu - il était stoppé. J'ai pris la coque, j'ai pris le p'tit, je l'ai emmené vers la porte 13, et je l'ai jeté DEHORS comme j'aurais lancé une boule de bowling sur de vieilles quilles. Retourne à la bêtise du monde j'ai pensé. Va t'en sans ton cadeau caché sous ton pull trop grand. Tes mains de petite frappe sales et malgré tout ça INNOCENTES.