SAMEDI
7 MARS 2015
de 14h00 à 19h00
dans le cadre du cycle
"Le conseil des Grandes Plumes"
Animation : Régis MOULU
Thème :
Se dégraisser des adjectifs (Hugo)
Que Victor Hugo ait lancé : « L’adjectif, c’est la graisse [dans le sens de lourdeur] du style » et aussi « Le style est âme et sang. Il provient de ce lieu profond où l'organisme aime » nous a profité au cours de cette nouvelle séance. Comme une impression de toucher à l'essentiel en l'exprimant avec efficacité est la richesse visée dans nos écrits lors de cette nouvelle exploration inédite.
Remarque : au-delà de la contrainte formelle, le sujet suivant a été énoncé en début de séance :
Ecriture en 2 temps:
1) imaginer une grosse valise oubliée chez un fleuriste (dans son magasin, cette valise ne lui appartenant pas) ; elle contient une photo et 2 objets que vous spécifiez sur un papier. L'animateur ramasse ensuite les papiers et les redistribue au hasard parmi les autres participants.
2) Ecrire ensuite un texte à partir de la valise imaginée par quelqu'un d'autre.
 Pour stimuler et renforcer l'écriture et les idées
de chacun, un support explicitant l'intérêt à ne pas utiliser d'adjectifs a été distribué en ouverture de session.
Pour stimuler et renforcer l'écriture et les idées
de chacun, un support explicitant l'intérêt à ne pas utiliser d'adjectifs a été distribué en ouverture de session.


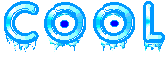

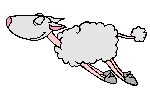
Ci-après
quelques textes produits durant la séance, notamment (dans l'ordre):
- "Le voyage du technicien" d'Ella KOZèS
- "L'énigme de l'homme des bois" de Marie-Odile GUIGNON
- "La valise de la fleuriste" de Christiane FAURIE
- "Ohé, ohé !" d'Angeline LAUNAY
- "Une potée de narcisses" de Nadine CHEVALIER
- "Le livre des légendes" de Janine NOWAK
- "Sur le chemin de Marguerite" de Murielle FLEURY
"Le voyage du technicien" d'Ella KOZèS
Une photo : quelqu’un (une) debout sur un plage- derrière des filaos, arbres du bord de plage dans l’océan indien- deux objets : un petit coquillage ovale nommé « grain de café » et un morceau de corail échoué sur la plage en forme de cœur
Dodo s’extirpe de son duvet, file mettre en route la cafetière pour que la boisson se prépare puis passe directement sa tête sous l’eau pour tenter de se réveiller. L’eau affronte les cheveux, glisse de toutes parts et finit par atteindre le cuir de son crâne. Le froid le saisit alors remettant en place ses idées. C’est le moment que la cafetière choisit pour se mettre à siffler. Dodo s’assoit devant l’étagère lui servant de table, attrape d’une main un « mug », et de l’autre soulève la cafetière. L’arôme du café se répand dans la chambre servant de pièce à vivre. Une à une, les gorgées se distillent dans son être. Dodo réveillé, risque un œil dehors : c’est encore la nuit et nous sommes en hiver. Un regard à sa montre lui indique qu’il ne faut pas traîner. La porte claque, les escaliers grincent, l’humidité et le froid n’ont pas le temps de le gagner qu’il est déjà dans les transports.
« dites-le avec des fleurs », telle est l’enseigne de son job du matin. Il déverrouille la grille de la porte de service, suspend son manteau en s’essuyant les pieds. Il préfère démarrer par l’atelier. Le voilà ramassant les queues d’oiseaux du paradis, et les déchets de tiges d’espèces dont il ne soupçonne pas même le nom. Lorsqu’il ne reste plus que de la poussière, il regroupe les sacs poubelles qu’il va jeter dans le conteneur et fait avancer l’aspirateur à renfort de coups de pieds. Le vrombissement de la machine à manger la saleté s’élève dans l’établissement. Il ne lui reste plus qu’à passer la serpillère. Il s’exécute en chantant avec un allant défiant le silence qui est retombé dans la boutique. Il chante qu’il ne faut pas oublier d’aller dans les coins, tous les coins… C’est alors qu’il la remarque : posée dans un angle, une valise sans âge, attire son regard. Il hésite, puis décide de terminer son travail avant de céder à sa curiosité.
Il n’est jamais allé aussi vite pour essorer la serpillère, rincer le seau, ranger la totalité du matériel dans le placard réservé à cet effet.
Dodo avance une chaise en direction de la valise. Il se laisse tomber dessus et vérifie qu’il lui reste du temps pour souffler tout en l’observant à la dérobé. Que fait-elle là ? A qui appartient-elle ? Est-elle oubliée ? A-t-elle été déposée en attente ? Osera-t-il y toucher ?
Puis il se lève, retourne dans l’atelier dont le sol a séché, ouvre le placard pour prélever une capsule de café et se prépare un « expresso » : l’affaire est d’importance ; une bombe pourrait être enfermée dans la valise et exploser à l’heure de pointe. Aujourd’hui samedi, la clientèle va se presser autour des étals du magasin et la bombe pourrait faire voler en éclats, outre la boutique (son lieu de travail), des vies venues chercher un peu de beauté, et de nature. Doit-il téléphoner au patron ? Prévenir les pompiers ? Appeler la police ?
Armé de sa tasse, il retourne s’assoir à proximité de la valise. Quiconque les observerait les trouveraient en plein dialogue. La valise semblait ne pas s’apercevoir des regards que Dodo lui lançait. Dodo, quant à lui, avait choisi d’apprivoiser le bagage en lui parlant. Il s’approche ce faisant, et pose ses mains au ralenti sur la poignée de la valise. Il inspire, puis attend quelques secondes. Parfois, pense-t-il, la bombe se déclenche avec retard. Prenant une seconde inspiration, il caresse les mécanismes d’ouverture. Il lève les clapets en retenant sa respiration. D’un coup, il les referme car il vient de décider qu’il fallait poser la valise à plat sur le sol avant tout. C’est ce qu’il fait, sans se presser. Il prend conscience que la mallette est quasiment vide. C’est donc avec soulagement qu’il décide de l’ouvrir. Il actionne les clapets et soulève le couvercle.
Ainsi qu’il venait de l’imaginer, le vide remplissait le bagage. Enfin, pas tout à fait. En réalité, deux vestiges retrouvent la lumière. Dodo attrape dans sa main le premier d’entre eux : un coquillage de la forme et de la couleur d’un grain de café. Comme un enfant, il le porte à son oreille et ferme les yeux. Le flux et le reflux de l’Océan emplit son cerveau. Il avance au niveau de son regard le second objet en forme de cœur et s’aperçoit qu’il s’agit d’un morceau de corail. Les mêmes questions qu’au début l’assaillent. Il remarque du sable emprisonné dans les angles en toile. Dodo se prend à rêver : la valise appartient sans doute à une adolescente. Collectionner les coquillages et les cœurs de corail ne peut être que l’œuvre d’une gamine. A moins, que ces objets soient le témoin d’enfance d’une adulte.
Dehors, le jour s’est levé. Dodo éteint les lumières pour ne pas attirer l’attention de l’extérieur. Il passe sa main au fond du couvercle et du bout de ses doigts découvre une pochette dans laquelle une partie de sa main s’engage. La pulpe de ses doigts en alerte lui indique une matière ressemblant à du papier. Il extirpe la feuille tout en tentant de deviner ce qui est représenté dessus. Ce n’est pas une lettre, il le sent, il le sait. L’épaisseur du papier se situe plutôt vers du cartonnage. Pourtant, ni la rigidité, ni la rugosité ne sont au rendez-vous. Ses yeux enregistrent une silhouette habillée de mousseline laissant transparaître l’ombre d’un corps. Son cerveau décode un lagon sur l’Océan Indien. La présence de filaos confirme cette déduction. Ces arbres du bord de plage ne se trouvent que dans cette contrée. Il s’en souvient. C’était avant. Avant qu’il ne quitte son pays avec ses parents. Avant le rêve de faire fortune de son père. Avant qu’il ne comprenne qu’il ne verrait plus le soleil de la même façon.
Dodo dépose le coquillage et le bout de corail dans la valise. Il range l’image dans sa pochette. La tête dans les étoiles, il referme la valisette et la repose à l’endroit où elle se trouvait. Il faut, se dit-il, que sa propriétaire puisse la retrouver à l’endroit où elle l’avait laissée.
La tête dans le ciel, Dodo referme la porte de la boutique de fleurs, et sans se retourner, continue son chemin pour attaquer un autre lieu de travail. Dodo ne voit pas les coquillages dénommés « grain de café » de toutes tailles posés sur les étagères de la vitrine. Il ne s’est pas aperçu que des bouquets de corail tenaient lieu de décor aux fleurs lointaines dont la boutique s’était fait une spécialité. Dodo se sent maintenant porté par l’Océan Indien qu’il ne reverra peut-être jamais, mais dont le rythme bat dans ses veines. Les vestiges de son passé ont surgi dans ce présent pour l’enchanter. Ces vestiges sont un présent.
"L'énigme de l'homme des bois" de Marie-Odile GUIGNON
Photo : Une forêt dans le lointain : En premier plan, une cabane de bûcheron – la cheminée fume – un stock de bûches contre la maison – Un chien est attaché près de sa niche. Un homme une hache à la main, coupe des bûches.
Objets : un pistolet et une machette pour tailler les broussailles.
Dans le fond d'une arrière-boutique de fleuriste, entre une armoire de métal et une commode de bois, derrière un fauteuil de toile et des rouleaux de papiers, une valise se camouflait par obligation.
Un amoncellement d'objets, de pots, d'arbustes, de plantes, la coinçaient.
Pourquoi était-elle là ? Elle se lamentait en silence, tentait de se secouer de la poussière qui la saupoudrait régulièrement. La vaillance qui l'agitait dans sa jeunesse s'étiolait. L'usure la gagnait progressivement, elle s'affaissait lentement, baillait d'ennui chaque jour un peu plus.
Le contenu s'était vidé des vêtements de soie qui caressaient la structure en peau de buffle, des mites avaient cambriolé les manteaux de laine, des souris logeaient dans les souliers de satin en s'aiguisaient les dents sur les lanières des sandales…
Pauvreté de valise ! Le malheur la recouvrait de désespoir !
Pour se remonter le moral, elle évoquait le bonheur d'avoir voyagé, en particulier de l'ultime expédition. Alors, énergiquement elle reprenait le dessus, elle resserrait les fermetures du double-fond, en vérifiait le contenu, se réjouissait d'avoir encore la capacité de conserver « LE TRESOR » que le propriétaire lui avait confié, soit :
- Un pistolet à canon de métal avec un mécanisme et un barillet en bronze. La poignée comportait des incrustations d'os et de nacre qui dessinaient des motifs de fleurs autour des initiales A et O en argent et or. Il se rangeait dans un étui en toile que décoraient des broderies .
- Une machette avec un manche en ébène qui s'ornait d'arabesques, d'émeraudes, de grenats, d'améthystes, de perles qui se disséminaient sur le pourtour du bois, l'ensemble reflétait la lumière. La lame éclairait comme un miroir mais son éclat se dissimulait dans un fourreau de peau de gazelle.
- Une photo se cachait dans une enveloppe, elle représentait « L'AMOUR de sa vie de valise » un homme, une hache à le main coupait des bûches à proximité du bûcher près de sa maison, la cheminée fumait, un chien attaché près d'une niche l'observait en silence. Dans le lointain une forêt, où, probablement, des arbres se balançaient langoureusement pour profiter de la fin de l'automne avant les frimas de l'hiver, les toisons de feuilles s'amenuisaient, les branches s'allégeaient avant de recueillir la neige.
Combien d'années coulèrent paisiblement dans la paix de l'ermitage du bout du monde ? Elle servait de huche. Il la cajolait, la caressait, l'ouvrait, la refermait, la rangeait, l'entretenait avec soin, elle respirait, se reposait, elle évoquait les souvenirs de périples dès que le regard de l'homme s'attardait dans la contemplation. Elle goûtait le silence de la communication.
Les heures glissaient dans la torpeur des saisons jusqu'à un jour, où il la saisit brutalement, enfouit rapidement sur le "TRESOR" des vêtements, la ferma, la jeta dans une jeep que conduisait un inconnu…
Le bruit de la ville résonnait sur les charnières de métal. Après des péripéties, elle se retrouva sur le trottoir devant le magasin de fleurs où l'inconnu entra en la tirant derrière lui. Il s'enfila au fond de l'arrière-boutique, la déposa, la dissimula entre l'armoire et la commode…
Depuis, elle stationne dans un fatras, réceptacle d'une vie d'oubli ayant pour consolation les effluves des parfums de fleurs.
"La valise de la fleuriste" de Christiane FAURIE
Photo : celle de mon fiancé d'il y a 30 ans et qui est devenu très moche. Il louche.
Objets: ses bésicles sont cassées et un savon qui pue.
Mon métier je l’ai choisi. D’aussi loin que ma mémoire me permet de le dire, j’ai voulu être fleuriste.
Les fleurs sont tapies en moi. Elles constituent mon bonheur, mon espérance.
Toute petite, je courais dans les blés à la recherche du coquelicot se dévêtant en offrant sa délicatesse au moindre vent.
Les clochettes du muguet résonnaient à mon coeur dans les sous bois tout en caressant les violettes à collerette, les freesias jeunes mariés, la mousse en tapis et les fougères paravent.
Marché conclu, je serai fleuriste.
A l’adolescence, j’étais amoureuse d’un homme aux yeux d’intellectuel derrière ses lunettes cerclées de noir.
Il disait que les fleurs ne servent qu’à entretenir l’illusion de la beauté ; qu’il fallait regarder la vie en face, sans fard, s’accrocher, se battre, avoir de l’ambition.
Dans ses yeux je lisais le mépris. Notre amour n’a pas résisté. Trente ans déjà, aucun regret !
Ma vie parmi les fleurs a eu raison de cet attachement passager.
Ces mélanges de parfums m’enivrent toujours autant. Les couleurs enchantent mon coeur. J’ai l’illusion qu’elles s’adressent à moi, qu’elles rivalisent entre elles pour rester à leur avantage.
Elles jouent des branches, allant même jusqu’à briser un vase trop ambitieux les reléguant au second rang.
Il suffit d’une peine de cœur et je me rapproche d’elles, leur parle, les observe. Leurs pétales sont le réceptacle de la pensée. Elles me guident.
Tout au long de la vie, elles offrent une alternative à la mort, un réconfort, une leçon de vie.
Ne dit-on pas « à la fleur de l’âge, fleur de lait, à fleur de peau, la fleur au fusil, la fleur aux dents, fleurer bon le frais, effeuiller la marguerite ? »
Pour exprimer ses sentiments à un être proche, ne s’inspire t’on pas du langage des fleurs ? Leur nom même est évocateur : oiseau du paradis, sabot de vénus…
Mais hier un événement inattendu a bouleversé tout cet équilibre.
Une valise au volume certain trônait là entre les allées sans que personne ne l’ai remarquée ou voulu la voir tellement elle était incongrue dans cet environnement.
Mais qui a bien pu l’oublier au regard de sa taille ?
Je la soulève et son contenu se répand au sol. Une paire de lunettes se brise au sol, un cadre laisse découvrir un homme d’une cinquantaine d’années. Son visage semble s’être déformé au cours des ans ? Ses sourcils épaissis donnent un regard vide de sentiments.
Je ne sais pourquoi mais il me semble reconnaître mon ancien fiancé Antoine.
Ses paroles me reviennent « ne pas entretenir l’illusion, se battre… »
Mais que lui est-il arrivé ? Son regard ne reflète plus rien, aucune flamme dans les yeux. L’œil gauche part à la dérive tandis que le droit tente de garder le cap.
Un savon est coincé dans le châssis du tableau. Cette odeur, mon Dieu ! Elle a du en laver des affronts, des injures, des accidents de vie, des sous-entendus.
Pourquoi a t’il échoué là entre mes fleurs ? Comment ne l’ai je pas vu déposer cette valise comme un acte d’allégeance ?
Il s’était donc trompé de chemin ou perdu en chemin, abîmé sur les bosses des routes ?
Il déclarait forfait, posait sa valise en pardon ?
Tout cela ne cadre pas avec l’homme que j’ai connu trente ans auparavant.
Aujourd’hui, je ne veux partager mes fleurs avec personne !
Les vendre à des inconnus me ravis. Je peux imaginer leur destinée, leur nouveau cadre de vie, leur angoisse en perdant leurs amies proches, en imaginant leur fin proche dans la poubelle ménagère.
Mais laisser cet homme refaire surface, s’enraciner, développer ses branches, lustrer son feuillage, NON !
Qu’il reste dans sa valise au grenier de l’indifférence !
Les fleurs coupées ont de beaux jours devant elles, elles ne prennent jamais racine chez qui les reçoit.
"Ohé, ohé !" d'Angeline LAUNAY
Une mer agitée
L’horizon est noir
Et les éclairs éclairent le ciel
Et crépitent pour s’éteindre dans l’eau
Accrochée au bastingage, je fais tout ce que je peux pour ne pas passer par-dessus bord, à tribord.
« Ohé, ohé, mets des voiles à ton voilier.
ohé, ohé, comment faire pour me sauver ? »
Epargner ma carcasse au sein de cette mélasse !
Reverrai-je un jour Horace ?
O désespoir qui me tenaille tandis que je lutte contre les éléments et contre moi-même.
Je suis blême.
Me voici dans la bataille, si près de la faille.
Au-dessus, la lune, les nuages menaçants, l’éternité et un jour, les turpitudes du temps, les tourments de l’amour.
Plonger ? Non, pas ça !
Mais plonger en moi pour voir de quoi je suis capable ou pétrie…
Suis-je une branche morte, une pierre polie ?
Oui, dans la valise oubliée chez le fleuriste, il y avait une branche morte et une pierre polie.
Une branche polie, une pierre morte.
Toi, la branche, Horace, et moi la pierre ?
Ou toi la pierre et moi la branche ?
Toi, le bois auquel je me chauffe et le rocher auquel je m’appuie…
A tort ou à raison, « sur les chemins d’ardente déraison ».
Ca tangue pour mon corps, ma tête, mon cœur.
Et j’ai peur. Je me sens en danger.
« Sonnez, sonnez, les sirènes au vent salé ».
Je guette une accalmie qui serait comme une amie.
Hélas, Horace, elle ne s’annonce pas.
Qui ne se ressemble pas, s’assemble ou pas ?
Tu es toujours dans l’urgence.
Je m’exerce à la patience.
Tu cours les jupons et moi les mers, quel enfer !
Nos routes finiront-elles par se croiser dans la savane des pétrifications, là où se niche l’habitation malgré tout ?
Mes questions se noient au creux des vagues qui se déchaînent ; elles augmentent ma peine.
Tel un continent qui se dissout dans le brouillard, tu restes là où nul ne peut t’atteindre.
Pourtant tu ne m’as pas écrit afin de feindre.
Tes lettres, je les relis les soirs d’intempéries.
Je les étale quand ça fait mal.
Je les presse, les froisse, les embrasse.
Ah, Horace, où es-tu, que fais-tu ?
Atteindrai-je l’île de la tortue sur laquelle l’aventure continue ?
Avec ou sans toi mais avec toi de préférence.
M’y rejoindras-tu un jour de délivrance ?
Délivre-moi de toi, délivre-toi de moi.
C’est tout et c’est assez.
Un jour, il n’y aura plus d’amour ou il n’y aura que l’amour.
Que voulez-vous qu’on y fasse ?
Se voiler la face ?
A quoi ça sert, quand on navigue en solitaire ?
« Ohé, ohé, mets des voiles à ton voilier ».
La lune me dit que « demain est un autre jour ».
Je lui réponds que je suis d’accord pour faire un détour, un crochet, Cap’tain Crochet, qui mènera à l’escale où te retrouver.
Qu’est-ce qu’on sera bien sur terre, même ente deux eaux, deux caractères.
Tu riras de mes tempêtes, de mes craintes et de mes audaces.
Et je n’attendrai rien de toi, Horace.
"Une potée de narcisses" de Nadine CHEVALIER
Photo : un paysage de montagne
Objet n°1 : une boite à musique
Objet n°2 : un livre de poche
Pierre allait fermer boutique. Comme chaque soir, il en faisait le tour, redressant les bouquets dans les seaux, y ajoutant un peu d'eau, caressant au passage chaque plante comme pour lui dire bonsoir.
Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir derrière le pot du philodendron, une valise à roulettes, en tissu à rayures.
Une seconde d'inquiétude le submergea. Valise... bombe ... attentat... Mais il se ressaisit vite et l'instant d'après, il sut, sans savoir dire pourquoi, à qui elle pouvait appartenir. Il revit cet homme en anorak et chaussures de randonnée qui lui avait posé tant de questions le matin. Pendant presque une heure, il l'avait interrogé, semblant s'étourdir de paroles.
" Pierre avait-il des edelweiss ou des gentianes ?"
" Les primevères pouvaient-elles être plantées au jardin après la floraison ?"
" Pouvait-on garder les jacinthes à la maison, refleuriraient-elles en fin d'année ?"
Pierre avait patiemment répondu à toutes ces interrogations, aucun autre client ne réclamant son attention.
L'homme expliqua que lui n'avait pas de jardin, que c'était pour sa mère...
Pierre réfléchit, comment retrouver cet homme ? Il n'avait pas coutume de noter les adresses des clients et l'homme avait payé en liquide.
Peut-être la valise lui apporterait-elle une information pour joindre son propriétaire ?
Et, la curiosité aidant, Pierre n'hésita pas longtemps.
La valise n'était pas fermée à clé. A l'intérieur ne se trouvaient que trois objets.
Aucun vêtement ou accessoire de toilette, aucun papier pouvant donner une adresse ou un numéro de téléphone.
Trois objets.
Un livre de poche, un policier de Simenon, du genre qu'on achète à la boutique de la gare pour passer le temps du voyage, aucune inscription dans les pages. Un livre qui n'a jamais été lu, se dit Pierre.
Puis une photo, en couleurs, de celle qu'on prenait avec les appareils dans les années 80, avant le numérique. Elle représente un paysage de montagne, en hiver, beaucoup de neige, un chalet au premier plan, une forêt de conifères, on imagine la neige glissant sur leurs branches sans bruit. C'est la photo du silence de la neige, se dit Pierre, se révélant poète pour le coup.
Au verso, une inscription, à l'encre, on le voit aux traces laissées par un frottement avant que l'écriture ne sèche. On peut y lire : "février 1998, quand reviendras-tu ?"
Ça fait 17 ans compte Pierre.
Le troisième objet est une boite à musique, à peine de la taille d'une boite d'allumettes. Elle tiendrait dans une poche, pense Pierre, pas besoin d'une valise.
Quand il l'ouvrit, quelques notes s'égrenèrent puis le silence se fit.
Pierre ne trouva pas comment remonter le mécanisme, un trou de serrure s'ouvrait dans le fond mais pas de clé.
Aucune possibilité de retrouver le type de ce matin avec ça, décida Pierre. Je suis sûr que c'est à lui. Il m'a acheté une potée de narcisses à la fin. Je m'en souviens très bien, il a insisté pour prendre un pot en terre, pas du plastique. Il a dit que sa mère avait horreur du plastique.
***
Au moment où Pierre ouvrait la valise, un homme en anorak et chaussures de randonnée, descendait du train à Chambéry .
Un peu plus tard, il arrivait dans cette maison où il avait vécu son enfance.
Voilà plus de vingt ans qu'il l'avait quittée, n'emportant dans sa poche que la boite à musique, héritage de sa grand-mère.
Il ne voulait rien devoir à ses parents, la colère lui brouillait alors le cœur et l'esprit.
Qu'en restait-il maintenant ?
Il devait faire le point sur sa vie et son avenir.
Il avait tout le temps à présent...
Il regrettait d'avoir perdu sa boite à musique et cette photo envoyée par sa mère à la mort de son père, comme un appel à la réconciliation... Quand reviendras-tu ?
Il revenait, mais trop tard...
Il alla déposer la potée de narcisses avec le pot en terre, pas en plastique, sur la tombe de sa mère.
"Le livre des légendes" de Janine NOWAK
Photo : un groupe d'hommes et de femmes. Elle est déchirée : il manque une partie de ce groupe qui apparait en premier plan. Sur le fond, des montagnes.
Objet n°1 : un révolver
Objet n°2 : un coupe-ongles
Stéphanie DURAND, fleuriste de son état, vient d’acquérir une boutique qui était en vente depuis des décennies. Les travaux de transformation sont sur le point de s’achever. Stéphanie apporte beaucoup de soin à la décoration de son magasin. En ce moment, elle restaure elle-même, une grosse valise - c’est même une malle - oubliée (ou laissée volontairement ?) par le précédent propriétaire du local. Cet objet de qualité lui plait. Elle estime qu’il fera de l’effet au milieu de ses plantes. La serrure était coincée par la rouille et la débloquer n’a pas été sans difficultés. Mais elle y est enfin parvenue hier, ce qui lui a permis de découvrir à l’intérieur du bagage, un ouvrage sur la Conquête de l’Ouest Américain, ainsi qu’un révolver qui semble dater de cette même époque. Très curieusement, comme pour attirer l’attention, le volume était ouvert à une page où figure une photographie. Ayant rendez-chez sa coiffeuse, Stéphanie décide d’emporter le livre, afin de tuer le temps quand elle sera sous le séchoir. La Coiffeuse : Bienvenue, Madame Durand ! Ainsi donc, comme convenu, pour aujourd’hui, ce sera la totale : shampooing, coupe, permanente. Et j’avais noté aussi, un soin des mains, n’est-ce pas ? Madame DURAND : En effet, Lucette. Mais j’espère que votre technicienne du coupe-ongle maniera son instrument avec plus de délicatesse que jeudi. J’ai failli y laisser une phalange ! La Coiffeuse : Soyez sans inquiétude, Madame DURAND. J’ai congédié cette manucure. Elle ne faisait pas l’affaire. Ma nouvelle recrue ne posera pas de problème : c’est une perle. Madame DURAND : Espérons… La Coiffeuse : Puis-je vous proposer un magazine, Madame Durand ? Madame DURAND : Non, merci, Lucette ; j’ai de quoi m’occuper. Un peu plus tard, sous son casque, Stéphanie ouvre son livre. C’est un recueil de légendes du Far-Ouest, légendes rédigées sous forme de poèmes en alexandrins. Elle débute par le texte qui lui était apparu en premier, celui incluant la photographie, et qui s’intitule : « La terreur de l’Arkansas ». Elle lit : « En ces temps de jadis, où la vie des humains Ne valait guère plus qu’une croûte de pain, A l’ombre des forêts, un homme chevauchait, Du soir jusqu’au matin, tel un halluciné. Sans répit, il allait, semblable au forcené Qui ne ressent ni lassitude, ni danger. Invectivant le ciel, il ressassait sa haine, S’enivrant de fatigue, pour alléger sa peine. Les yeux obstinément fixés sur l’horizon, Il courait les chemins, vêtu de ses haillons. Il savait qu’aucune fuite ne pourrait apaiser Ce mal qui le torturait et le consumait, Et qui un jour finirait bien par le tuer. Mais c’était plus fort que lui : il fallait qu’il aille, Là où le hasard le conduisait, vaille que vaille. Méprisant ses semblables, il avait sciemment, Dans un coin de montagne, établi campement. La nature lui offrait de quoi se sustenter : Les carpes des étangs, les truites et les brochets Des rivières, à son ordinaire pourvoyaient. Et la chasse apportait son content de gibier. Méfiant, il se tenait à l’écart des sentiers, Où le risque de croiser des quidams existait. Par son regard d’acier, la crainte il inspirait. Souvent, à son approche, les autres s’enfuyaient. Muni d’un révolver dont il savait user, Sans un mot il pouvait inspirer le respect. Toujours sur le qui-vive, loin des autres il vivait, Sans jamais éprouver le besoin d’approcher Tous ces gens sans pitié, qui une fois, rassemblés, Comme des bêtes agissaient, prêts à mordre et à tuer. Jadis, dans sa jeunesse, on vantait sa bonté. Mais un jour par malheur, tout avait basculé. Un soir, afin d’aider un noir persécuté Par un groupe d’excités, qui voulaient le lyncher, Il s’était approché, affrontant le danger, Un sourire sur les lèvres, en réclamant la paix. Ils se sont tous rués, prêts à le massacrer, L’injuriant, le frappant, le tuant à moitié. Suite à cet épisode, il ne fut plus le même. Et depuis ce temps là, il erre avec sa peine. Cette épopée est le reflet de la réalité. L’auteur de ce poème a voulu rapporter les faits tels qu’ils s’étaient déroulés. Pour donner plus de poids à son récit, l’écrivain a inséré, au bas de son texte, un cliché couleur sépia, dont il manque un morceau. Sur cette photographie, on aperçoit, sur fond de montagnes, un groupe d’hommes et de femmes, face à un adolescent, qui, mains tendues, semble réclamer de l’apaisement. Stéphanie referme le livre, saisie par l’émotion. Un trouble l’envahit. Elle se demande si le vieillard sans descendance à qui elle a acheté le magasin, a un lien de parenté avec le héros de cette histoire ? Ce serait extraordinaire… La présence du révolver qui a tout d’une antiquité le ferait penser… Et puis, pourquoi avoir mis en évidence, précisément cette histoire ? Ces objets ont-ils été laissés exprès, afin qu’un jour quelqu’un les trouve, les exhume, leur redonne vie, et tire ainsi de l’oubli cet aïeul ( ?) dont l’existence n’a été que plaies et bosses ? Il faut qu’elle interroge au plus vite ce presque centenaire. Elle a besoin de savoir.
"Sur le chemin de Marguerite" de Murielle FLEURY
Photo : celle d'un mariage « de l’époque » avec un lieutenant moustachu et une jolie femme dont les cheveux sont partiellement serrés sous une sorte de casque blanc (en tissu) avec un départ de voile.
Objet n°1 : « Le petit Prince » de Saint Exupéry en livre de poche
Objet n°2 : des chaussures d’enfant, vernies noires... des chaussures du dimanche !
Il lui avait fallu se ré-acclimater très vite, sitôt qu’elle était rentrée chez elle, après le safari à la découverte des animaux de la savane, et les nuits à entendre les bruits de la jungle. La vie après repris ses droits. Deux jours après son retour, Nicole avait repris le chemin de l’auto-école qu’elle gérait avec son mari depuis 35 ans à Niort. Des heures à enseigner les rudiments de la conduite, des journées à repasser des séries de situations à des apprentis sans concentration. Si cela avait dépendu d’elle, elle leur aurait donné tout de suite, et à tous, leur permis, et qu’on n’en parle plus, et tant pis pour le danger qu’ils représentaient au volant ! La violence du contraste avec son équipée en Tanzanie ne lui laissait pas de répit. Pour atténuer le changement, elle avait couru chez la fleuriste en bas de chez elle se confier et choisir un bouquet. La fleuriste était devenue son amie, sa confidente. La vue des fleurs qu’elle affectionnait par-dessus tout n’avait pas suffi pas à apaiser la puissance de sa nostalgie. Elle éclata en sanglots. Là-bas, elle avait revécu par procuration la vie de son aïeule Marguerite, qui avait épousé Maurice, un lieutenant ; ensemble, ils avaient vécu 20 ans en Afrique. Elle leur avait imaginé une vie de mondanités, de rencontres et de découvertes, et plein de domestiques à leur service. Ils avaient fréquenté tout à la fois des aventuriers, des militaires et des aristocrates. Sur place, Marguerite avait ouvert une école que garçons et filles des villages alentour pouvaient suivre. Elle s’occupait aussi d’un dispensaire. La légende de la famille rapportait que Marguerite assistait le médecin avec beaucoup de zèle et l’accompagnait si nécessaire en brousse pour des interventions à risque. Enfant, Nicole avait souvent regardé à s’en user les yeux les photos de Maurice, un pied sur la dépouille d’un éléphant ou bien d’un tigre, et entouré de boys. Ou bien des photos de Marguerite et Maurice au Kenya, à la plantation de café qu’ils avaient acquis. Elle admirait leur élégance, leur nonchalance, et devinait leur bonheur. Dans sa chambre au-dessus de l’auto-école, elle laissait aujourd’hui cette imagerie agir sur elle comme un philtre. Elle s’en abreuvait, le respirait comme de l’opium, y puisant un remède pour supporter sa vie à Niort. Sans convoquer ces images, elle ne pouvait désormais plus trouver le sommeil. Elle, elle n’avait pas de ferme en Afrique ni Robert Redford pour lui laver les cheveux dans la brousse, au crépuscule, quand les lions viennent boire. Avec son mari, elle ne partageait plus guère que la comptabilité de l’entreprise. Un mois après son retour, Nadine s’en fit la promesse : elle épargnerait sou à sou et elle repartirait, sans son mari, et définitivement cette fois. Elle ne le supportait plus. Les enfants vivaient leurs vies de leur côté, elle ne leur manquerait pas, ou bien, ils viendraient la voir et le reste du temps ils communiqueraient ensemble via Skype. La sensation d’oppression qui ne la quittait plus depuis son retour lâcha un peu son emprise. Elle respirait mieux. Elle sentait que Marguerite veillait sur elle. Elle fit du tri dans ses affaires, en jeta beaucoup, sans regret. Elle prépara plusieurs valises : à garder, à jeter, à donner. Pêle-mêle, elle mélangeait les époques, les objets, leur valeur, selon des priorités qui n’appartenaient qu’à elle. Sa vie défilait comme en accéléré. Elle descendit son viatique chez son amie la fleuriste, dans une valise. Il contenait ses trésors : la photo de mariage de Marguerite et Maurice, une paire de chaussures de dimanche de sa fille, morte d’une pneumonie à 8 ans et « le Petit Prince », le livre qu’elle lui avait lu avant même qu’elle sache en déchiffrer les lignes, et qui contenait les dessins que l’enfant avait gribouillés sur les pages.