SAMEDI
11 AVRIL 2015
de 14h00 à 19h00
dans le cadre du cycle
"Le conseil des Grandes Plumes"
Animation : Régis MOULU
Thème :
Se transporter dans les personnages (Flaubert)
S'adressant à G. Sand, Gustave Flaubert rédige : « Il faut, par un effort d'esprit, se transporter dans les personnages et non les attirer à soi ». Il ajoutera à ce sujet, que s'il écrit si lentement, c'est parce que rien n'est tiré de lui. Avec cette méthode productive qui consiste, à force d'imagination et de volonté, à "s'objectiver", on essaiera au cours de cette nouvelle séance inédite de se perdre complètement dans la vie des personnages créés, tout comme un acteur serait convaincu qu'il ne joue pas mais qu'il est ce qu'il joue, la nuance est de taille.
Remarque : au-delà de la contrainte formelle (thème), ce sujet a été lancé en début de séance : Il/Elle s’appelait [...] et nous vivions un roman à l’eau de Cologne (frictions)
 Pour stimuler et renforcer l'écriture et les idées
de chacun, un support détaillant la construction d'un personnage ainsi que les procédés "pour investir le champ bourgeonnant des émotions" a été distribué en ouverture de session.
Pour stimuler et renforcer l'écriture et les idées
de chacun, un support détaillant la construction d'un personnage ainsi que les procédés "pour investir le champ bourgeonnant des émotions" a été distribué en ouverture de session.
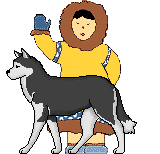




Ci-après
quelques textes produits durant la séance, notamment (dans l'ordre):
- "Nous" de Marie-Odile GUIGNON
- "Bas les masques" d'Ella KOZèS
- "Espèce d'empaillé !" de Régis MOULU
- "La caravane des clowns" de Nadine CHEVALIER
"La tache" de Janine NOWAK
"Nous" de Marie-Odile GUIGNON
Elle s'appelait Annata et nous vivions de l'air pollué de nos existences,
le plus pur dans le ciel de notre relation.
Sa silhouette fine voguait dans l'espace, tel un oiseau blanc se moquant
des coups de vent.
Ses vêtements glissaient sur ses apparences selon les activités de ses
journées. Elle aimait l'aventure silencieuse. L'attraction n'avait pas
de prise sur ses décisions. Elle suivait des traces non-identifiables,
il fallait l'accepter.
Généreuse et insouciante, elle pouvait se brûler les ailes à la
mesquinerie des autres. Je ne parlerai pas de son métier ni de ses
collaborateurs, nous professions aux antipodes, nous ne résidions pas à
l'ombre des mêmes murailles.
J'assumais les conséquences quand les silences ou les flots se
déversaient en nuits de tourmente.
Les orages s'éternisaient rarement.
La lumière de ses rires annonçait un nouveau départ.
Son imagination fertile galopait vers d'autres rencontres, d'autres
objectifs, elle m’entraînait dans son orbite, me lançait : j'étais
satellite… Nous repartions dans notre univers…
Elle nageait dans son quotidien en dauphin conquérant. Je n'aimais pas
la natation, je n'y trouvais pas d'oxygène. La noyade me guettait à
chaque mouvement de brasse. Alors je regagnais la terre ferme,
solitaire, avec un sentiment d'abandon difficile à contenir.
Un voyage achevé, Annata retrouvait le nid douillet pour s'y lover dans
la tiédeur. La raison l'habitait subitement, nous jouions une partition
dans le même tempo, mesures hors du temps hélas vite désaccordées par la
monotonie d'une mélodie sans couleur.
Non pas que le bonheur agisse comme une drogue dont l'effet s'amenuise,
mais seulement l'effet de la lassitude d'un électrocardiogramme plat.
Peut-être que mon esprit s'enfuyait vers mes intérêts terre à terre…
Dans mon absence de vigilance, j'oubliais la clairière où nous
pique-niquions sur l'herbe fraîche des impressions partagées. Trop tard.
Deux mondes alors se côtoyaient, chemins parallèles : moi circulant à
grande vitesse sur l'autoroute, elle randonnant sur le chemin vicinal,
aux détours pleins de surprises, souvent tortueux et peu carrossable.
Elle choisissait l'engagement loin des sentiers battus sous le prétexte
de rencontrer la vérité du sens de la vie.
Sa vie, elle ressemblait à un appareil photographique, pas à une caméra,
elle collectionnait des réalités fixes, pas de la mouvance. Elle vivait
de mouvance pour la jalonner de points de repère.
J'attendais, amer, une bifurcation, un lieu de ravitaillement commun.
Cela se produisait en général par je ne sais quelle alchimie !
Nous dansions de nouveau la même valse, tournoyions dans l'euphorie de
l'instant, nous échangions le quotidien, recevions des amis, consommions
des repas de famille, célébrions les anniversaires, organisions des fêtes…
Quoi !
Nous atterrissions dans le réel qui serpente et inculque le venin de
l'évasion !
Subitement Annata disparaissait, insaisissable.
L'incompréhension s'allongeait sur le divan de notre vie sentimentale
pour l'écraser de son poids.
Je m'enfonçais au fond de ma grotte préhistorique en attendant une ère
nouvelle avec l'espoir d'un tremblement de terre qui me ferait
disparaître...
Quand les effluves d'un parfum connu s'insinuaient dans les couloirs de
mes narines, je suivais immédiatement son filet en l'inspirant fortement
pour qu'il pénètre dans mes poumons et s'infiltre jusqu'à mon cœur pour
me conduire au-dehors…
Pour... Vivre de nouveau, dans le ciel le plus pur de notre relation à Annata et
moi, en inhalant l'air pollué de nos existences.
"Bas les masques" d'Ella KOZèS
« Jean-Philippe de Gaujac, artiste musicien, premier prix de Rome ». Les lettres de feu s’étalent sur la porte d’entrée qui mène à son premier cours avec le grand homme. La plaque de cuivre polie attire le regard comme un flash publicitaire de mauvais goût, mais Lucie, du haut de son mètre quatre-vingt-cinq ne l’aperçoit pas. Son attention est bien trop focalisée sur la sonate qu’elle doit jouer devant ce concertiste de renom.
Debout dans un pantalon noir, au milieu du salon chargé de dorures, les yeux fermés, Lucie laisse ses mains jouer, son violon chanter, son âme l’emporter. Elle est devenue l’ange harmonieux et léger du plafond peint, la colombe de Magritte qui doucement, va se percher sur l’épaule de son auditeur attentif. Lorsqu’elle repose son archer dans un de ces silences qui laisse entendre une note infinie, nul besoin d’ouvrir les yeux pour savoir qu’ils viennent de vivre, l’un et l’autre, un moment de communion intense.
Ils ne bougent pas que déjà ils s’appartiennent. Ils ne parlent pas encore que les promesses s’inscrivent dans sa chair pour lui, dans son esprit pour elle.
Posément, l’homme de petite taille, serré dans un polo ajusté, s’installe au piano et entame un morceau endiablé de Dvorjak. Le son du violon rejoint d’abord timidement celui des cordes martelées, puis il s’enhardit au fil des caresses de l’archer pour une partie de Colin-maillard où ils se poursuivent, se retrouvent pour s’éloigner à nouveau et se rendre enfin l’un à l’autre, dans un tendre duo.
Ce soir-là, Jean-Philippe, la demande en mariage. Elle décide de le faire attendre… jusqu’au lendemain matin pour lui dire « oui » au petit-déjeuner, qu’il lui sert avec bonheur. Un mois plus tard, ils se marient devant deux agents du service public qui ont accepté d’être leurs témoins. Jean-Philippe a souhaité faire table rase pour repartir à zéro avec la femme de sa vie, de vingt ans sa cadette. Lucie, quant à elle, ne s’étonne de rien. Il est son idole et l’entraîne alors dans une série de concerts à l’étranger. Le succès flamboyant est au rendez-vous. Il attire sur eux des regards de convoitise et attise les désirs.
Le maître se tourne parfois vers d’autres jeunes talents et Lucie n’y voit que la grande bonté d’un professeur exigeant qui se met au service de la musique.
Alertée par une cantatrice sur l’attitude de son mari pouvant prêter à confusion, elle finit par s’en ouvrir à lui. Elle lui recommande de ne pas générer de faux espoirs. Jean-Philippe se redresse de toute sa taille pour tenter de la toiser pendant quelques longues secondes. Il esquisse un sourire condescendant, et la rassure.
Depuis cet échange, Lucie ressent un malaise. Elle est sensible au décalage, à la fin du rêve. Elle l’observe à la dérobée et réalise qu’il l’enferme dans le rôle de la conjointe avec les corvées habituelles. Elle continue bien à jouer du violon, mais ne rêve plus de devenir soliste. Et pour cause ! Il lui faut faire le ménage, le repassage, les courses, les repas lorsqu’ils ne sont pas en tournée. Elle le voit rentrer assez tard quand il est de repos. Ses silences ont changé de qualité : ils sont devenus moroses, vides de sens. Son regard ne s’anime que lorsqu’il est entouré, voire adulé. Dans ces instants-là, il redevient l’aimant attirant pour elle. Mais même à ces moments privilégiés, elle souffre de ne plus exister pour lui. Il est ailleurs, pointé vers plus jeune, plus belle, et peut-être plus talentueuse.
Le temps des croches est arrivé. Pas un soir sans que leur partition de couple ne soit le reflet d’une bataille. Pas de pause pour eux. Elle donne dans le picolo quand il bat du tambour. Ils sont en guerre et les voisins sont contraints de frapper à la porte pour réclamer la paix. Méprisante, elle sait qu’il ne supportera pas cette image donnée à l’extérieur. Elle a appris qu’il maquille leurs cris derrière une répétition théâtrale imaginaire. Une création moderne, lui a demandé le voisin gouailleur ? Une vieille tragédie ! lui a-t-elle répondu sur un air vengeur.
L’observation se fait plus aigüe. Lucie ouvre enfin les yeux sur cet homme droit comme un « i » dès qu’un œil l’observe, tiré à quatre épingles et sanglé dans son éternel polo ; ce héros qui ne vit plus que le temps d’un concert, ne jouit plus que lors d’applaudissements, et qui, au prétexte d’une assurance sur ses mains, ne participe pas aux travaux ménagers.
Elle a mis à nu l’artiste dont elle connait par cœur les rides, dans lesquelles elle lisait un avenir radieux. Elle le voit faible, démuni d’empathie, à la recherche permanente d’une flambée d’admiration pour survivre dans un monde qu’il rend glacial. Elle le regarde enfermé en lui-même, certain d’avoir toujours raison, assénant sa vérité comme si elle était unique. Elle aura mis dix ans à ouvrir les yeux depuis sa première audition. Dix années de sa vie qu’elle lui a laissée. Dix années de sa vie perdues au profit d’un technicien démuni du fameux supplément d’âme.
Lors du prochain départ en tournée du grand musicien, elle fera ses bagages et quittera définitivement l’appartement parisien. C’est alors qu’elle apercevra la vilaine plaque de cuivre sur laquelle de mauvais caractères noirs gravés en creux annoncent « Jean-Philippe de Gaujac, artiste musicien, premier prix de Rome ». C’est à ce moment-là qu’elle comprend qu’elle-même, Lucie de Gaujac depuis dix ans, n’avait jamais existée pour le postier.
"Espèce d'empaillé !" de Régis MOULU, animateur de l'atelier
Il s'appelait Césario
et nous vivions une romance
à l'eau de Cologne.
Du cheval ! Envie de faire du cheval !
c'est ce qui m'électrisait les cuisses chaque mercredi !
Le jour de notre première rencontre,
lui était déjà dans le box,
au milieu du foin
comme un cèpe qui dépasse de sa mousse.
Il était joufflu.
Des lèvres comme une prune sous le soleil,
avec une moustache comme
un gribouillis à cheval sur sa prune !
Ses yeux, telles deux pointes de parapluies indigo
sont venues frapper à mon cœur.
« Josépha ! » que je lui dis pour me nommer,
« Vous êtes mon cheval ? » que j'ajoute pour le sonner !
À croire qu'il était étranger.
Un silence interminable nous nappa…
Et j'ai pris cela
pour le Vésuve de la tendresse,
« quelle connerie ! » je peux dire aujourd'hui !
« Césario ! » qu'il me fait,
comme un tuberculeux cracherait son glaviot…
Pourquoi n'ai-je pas senti à ce moment
que démarrait ma perte programmée.
Mon fantôme n'était même pas là pour m'alerter !
Une pauvre femme de chair et de larmes, je suis,
rien de plus,
mon âme est partie en vacances sans billet retour,
je me sens si affligée
que je me verrais bien finir en couturière
pour poupées…
« Je plaisantais Monsieur,
je sais que je vous aime,
je suis sûre que nos organes
dans le coffre qu'est notre corps
sont autant de pierres précieuses
qui ne songent plus qu'à se méli-méloter,
soyons fous ! soyons licencieux ! tressons nos doigts et le reste pour l'éternité ! »
C'était comme si on avait décapé
la case de l'équidé
tant nos corps fiévreux
balayèrent les lieux !
Je ne fis plus jamais du cheval
vu ce nouvel abonnement
pour d'autres exercices !
Césario était caissier principal,
amateur de tiercé,
de thé à l'aubépine,
de dimanches surchargés,
de cravates fleuries,
de pistaches
et de femmes déraisonnables,
un club qu'il entretenait
et dans lequel je venais d'entrer
comme une promeneuse étourdie se laisserait happer
par un troupeau de brebis
en transhumance.
On se vit de plus en plus de fois,
de plus en plus souvent,
de plus en plus intensément,
quand je voyais sa gourmette
qui mettait en avant
son prénom en lettre d'argent,
il me semblait être au pied de l'Olympia !
Ah ! comme j'ai pu avec mes mains parcourir son corps défait !
Et il se laissait picorer d'amour
tel un os de seiche offert aux linottes.
C'est d'ailleurs peut-être cela la puissance des tyrans :
ne rien faire
puisqu'on a laissé toutes ses peurs au vestiaire !
Il me disait que j'étais envoûtante,
j'en ronronnais de plaisir
lorsqu'il débridait mon chouchou Prisunic.
Puis il ajoutait
comme une rombière balancerait du pain rassis
aux cygnes :
« pour moi, ton corps est infini,
accepte au plus profond de toi
que je sois ton Christophe Colomb ! »
C'est bien simple, à entendre cela,
je me suis évanouie
tellement j'ai bien cru m'évanouir !
Il gardait toujours dans la poche gauche de son veston
un de mes deux bas,
même au boulot !
Pour un banquier,
je trouvais ça risqué,
ça m'excitait !
je me suis mise à lui écrire des mots
que remplacèrent rapidement des dessins obscènes !
bref, je sais ce que c'est que d'avoir été folle !
ah ! j'en ris !
Nous étions en mai,
et je ne sais pas pourquoi,
la grosse Topaze
montée en bague
qui me venait de ma mère défunte,
je ne m'aperçus pas
qu'elle n'était déjà plus
dans le chou-fleur en plastique
du frigo.
Dieu,
comment se fait-il
qu'avancer dans la vie
se résume toujours à l'impression
de se faire mutiler d'un bras ou autre
à chaque drame que nous rencontrons !
Bien que désossée
et quelque peu « fortement équarrie »,
mon grand sourire – que je maîtrisais à merveille –
reconstituait ma silhouette massacrée.
« Césario, je te déteste,
tu es un beau salopard ! »,
caissier en « costume de lin-cravate en soie jaune »
la journée
et dépeceur à loisirs d'âme d'amantes
la nuit !!
Ce n'était pas facile de se procurer un revolver…
contrairement à la décision de le faire !
Ma vie était devenue un enfer rougeoyant,
une fête à laquelle je me voyais participer
sauf que je n'avais pas le bon costume :
en somme,
j'étais
comme
une danseuse de cabaret new burlesque
dans un congrès d'évêques à jeun !..
On avait tout pour se rencontrer avec fulgurance
et se détruire à petit feu…
l'enfer rougeoyant, quoi !
Quand il me demanda de vendre
mon tableau préféré,
un lapin éventré en nature morte
qui était au milieu d'un gang de citrons,
pour qu'on achète une villa à Cabourg,
la fougue que j'avais pour ses rouflaquettes s'enflammant au moindre rayon de soleil,
me poussa à m'exécuter.
C'était quand même un De Coninck
hérité de la famille de mon défunt époux,
le premier.
On en a fait des pics de vitesse
sur les bords de mer !
à se courser !
à s'attraper !
à s'infliger des baisers salés et autres mordillages
comme on savoure des dragées
par succions successives
avant de croquer l'amande
qui libère d'autant plus de parfum
qu'elle a été longtemps enfermée !
Ses yeux brillaient
telles des cuillères argentées
surtout lorsqu'il arrêtait son regard
sur mes cheveux qu'il disait « caramel ».
Et puis nous suivions
immanquablement des yeux
les mouettes
comme pour prendre
un peu de leur liberté criarde.
Et sa perversité le poussait d'ailleurs
à me déclarer
avec une théâtralité
basée sur la technique de la « rate à vif » :
« Si tu vois la beauté fatale
de cette sterne, là-haut, au large,
tu n'auras pas de mal
à nous faire partir en ballon
dans le pays où n'habitent que
des cœurs qui, à longueur de journée,
broutent de l'amour ! »
Sur le moment,
je n'avais rien compris.
J'insistai donc
pour qu'il l'écrivît
sur un bout de papier
que je déchirai du Temps perdu
que j'avais sur moi.
Il eut du mal à la retrouver,
j'aurais dû y déceler un signe d'imposture,
à la place, je suçai une réglisse,
puis une autre,
puis une troisième
afin que ne retombât jamais ma tension,
cette envie de lui sauter dessus
comme on déballe un cadeau
qu'on a beaucoup imaginé,
je soufre.
Le soir même,
son papier,
je le mis sur mon plexus
comme pour entendre sa respiration,
je me vis alors
au milieu d'une clairière
où écumaient des bananiers
et des cris de perruches bariolées,
en quelque sorte,
une ode à la sauvagerie
y triomphait insolemment !
Plus je respirai profondément
sur son sofa rouge sang caillé,
et plus il me semblait
que la terre m'enlaçait
avec ses bras tourbeux :
une façon de rêve
en voyage volcanique
qui me plaçait
dans un grand toboggan
au milieu des fleurs géantes
aux couleurs toutes improbables !
La vitesse de ma glissade
faisait d'ailleurs office de machette !
ou plutôt de peigne
qui ordonnait ces tendres chéries
en orgue dont les tubes, parce que parallèles,
ne pouvaient que mieux convoquer le ciel !
Cette nuit fut particulièrement courte
vu tout ce que je vécus
durant mon sommeil !..
« La beauté fatale de cette sterne »…
« fatale » !?
Comment est-ce possible d'être si aveugle,
si sourde,
si amoureuse,
si exposée aux malheurs !?
On aurait dit que la crosse
de mon arme à feu
était faite pour ma paume :
son canon me constituait simplement
un doigt supplémentaire.
et je m'entrainai à le manipuler
devant mon psyché
comme si j'étais Calamity Jane.
De la jonglerie en somme.
J'étais plus que prête,
à la limite commençai même à flétrir !
Quelle étourdissante liste
que tout ce qu'il m'extirpa !
le pire étant mon âme
foulée,
malaxée,
cuite et recuite
telle une pâte à pizza
oubliée dans le four.
C'était un 1er mai.
On était au zoo de Vincennes,
devant les ours.
« Regarde bien ces mammifères ! »
que je lui fais !
« Si tu vois leur férocité fatale,
là-haut, au milieu des rochers,
tu n'auras pas de mal
à partir sous la balle de mon pistolet,
au pays où n'habitent que
les cons qui, à longueur de journée,
broutent l'amour des autres !
« Et pan ! »
fit le nuage de fumée !
En face, les otaries disparurent.
Une fillette à couettes
bien symétriques
n'avait en main
plus qu'un cornet,
les deux boules fraise-fraise
ayant dévalé.
La bouche de Césario
moussa dans ma direction
un « pourquoi, mon ange ?...
pourquoi tu vises si mal les ours ?! »
Il n'avait rien compris.
Pas plus que le commissaire
qui m'auditionna.
C'était un grand quinquagénaire
dont les cheveux du genre lichen
laissaient part belle à la poésie.
J'aimais sa façon d'embrasser,
avec méthode et soin,
comme il en faut sur les scènes de crime.
Au parloir,
il venait me voir
tous les jours.
Notre envie de nous détrousser
les principes les plus ancrés
nous poussa rapidement
à imaginer mon évasion.
Je rêve souvent de lui,
« à vie » comme on dit
quand l'avenir ne veut plus de nous…
Elle pleure.
Fin de l'épisode.
Le prochain déjà tourné
fait encore l'objet,
malheureusement,
de négociation avec le programmateur,
ce n'est donc pas demain
qu'aura lieu sa diffusion !
… mais on ne sait jamais !
"La caravane des clowns" de Nadine CHEVALIER
J'étais employée à la mairie de Champacourt quand j'ai rencontré Auguste Barthélémy pour la première fois.
Il venait chercher les autorisations pour l'installation du cirque sur le terrain de sport municipal.
Il n'avait pas fait la demande dans les délais légaux et se trouvait donc en difficulté.
Dès que j'ai vu cet homme grand, brun, aux yeux bleus rieurs, à la voix grave, je me suis sentie comme une midinette devant une star de cinéma. Je l'imaginais trapéziste, ou acrobate, dompteur de lions peut-être, en costume chamarré, le fouet à la main.
Alors, j'ai fait ce que j'avais toujours refusé de faire pour tous les autres : j'ai parlé au maire pour qu'il signe les papiers. J'étais alors sa maîtresse, il ne me refusait rien.
Pour me remercier Auguste Barthélémy m'invita à dîner. Je fus trop heureuse d'accepter.
Il raconta qu'il travaillait dans ce cirque depuis une dizaine d'années, secrétariat, comptabilité... c'était un petit cirque mais qui avait du succès dans les villages. Cette vie lui plaisait.
Je lui parlais de ma vie de secrétaire de mairie et de mon envie d'évasion...
Ce soir là, je ne dis non à rien de ce qu'il me proposa et je terminais la nuit dans une caravane de cirque, me traitant de fille facile et de dévergondée mais incapable de résister à mon désir.
Le lendemain soir, je me rendis au spectacle mais je ne vis pas Auguste Barthélémy. Il n'était ni trapéziste, ni acrobate. Il n'y avait pas de lion. Le magicien était un petit homme corpulent, les funambules deux jeunes gens aux allures androgynes.
Le spectacle touchait à sa fin quand je reconnus la voix d'Auguste Barthélémy venant des coulisses. C'était le numéro des clowns !
Moi, amoureuse d'un clown, je ne l'imaginais même pas possible...
Et pourtant me dis-je, avec un nom pareil, j'aurais dû m'en douter !
Mais j'étais déçue, il me faut l'avouer. Rêver de Spartacus et tomber sur Zavatta ...
Mais voilà, cette aventure avec un clown était resté gravée dans mon cœur. Qu'importe le métier, c'est l'homme qui compte, me répétais-je ...
C'est ainsi qu'un soir; je me suis trouvée à frapper à la porte d'une caravane de cirque dans un village perdu. Auguste Barthélémy a ouvert. Dans un instant de panique, j'ai cru qu'il n'était pas seul. Mais il a tendu les bras et je suis entrée.
On dit parfois que les clowns sont des gens tristes dans la vie ordinaire mais pas Auguste Barthélemy. C'est un homme qui aime la vie et les gens, il est joyeux et fait partager cette joie autour de lui. C'est le meilleur des clowns que je connaisse. Bon, évidemment, je ne connais que lui comme clown, suis-je bien placée pour donner un avis ?
Voilà huit ans que je partage sa vie et sa caravane, j'ai tout lâché pour le suivre.
Après chaque représentation, Auguste Barthélemy enlève sa salopette et ses chaussures vertes pointure 74. Il s'assied lourdement devant le miroir et retire sa perruque frisée bleue et son nez rouge, les dépose avec précaution dans la valise où il a déjà pliée sa veste fleurie.
Ce soir, je le regarde, mon chapeau blanc à la main, n'osant dire un mot. Je sais qu'il va ensuite se démaquiller avec soin, fermer la valise et sortir de la caravane.
Il ne me dira pas où il va.
Moi-même, ce soir, je vais sortir. Je ne lui dirai pas où je vais.
Le cirque est à Champacourt, comme chaque année. Je rends visite à Florent, l'ancien maire...
Demain, nous repartirons sur les routes, Auguste Barthélemy et moi dans la caravane des clowns.
"La tache" de Janine NOWAK
Elle s’appelait France. Sa famille résidait dans ce que les personnes de condition modeste appellent, avec un brin d’envie, « Les Beaux Quartiers ». C’était le début de l’été 1957. La radio diffusait une chanson à la mode où Dalida racontait les amours contrariées de Bambino. Je venais de passer avec succès les épreuves du Brevet. A la rentrée prochaine, l’unique Lycée de la ville allait m’accueillir…ainsi que France ! Enfin, je pourrai la voir tous les jours. Jusqu’à présent, elle avait été scolarisée, à l’instar de tous les enfants des « Gens Biens », chez les « Bonnes Sœurs », comme on disait chez moi, en pinçant la bouche. Ma Grand-Mère ajoutait volontiers, que « ces familles de la Haute n’aimaient pas mélanger les torchons avec les serviettes ». A cette époque, ces considérations de classes sociales me passaient par-dessus la tête. J’avais été un bébé rieur, puis un petit enfant joyeux, insouciant, pas compliqué, aimant plus que tout jouer aux billes. Je ne m’étais jamais beaucoup interrogé sur le passé de ma famille, prenant la vie du bon côté, l’acceptant telle qu’elle venait, sans me torturer l’esprit. Pourtant, c’était un fait, ma situation familiale n’était pas à l’image de celle de mes petits camarades. A la maison, pas de père. Et ma mère, s’absentait toute la semaine, n’ayant trouvé du travail qu’à Paris, me disait-on... Je vivais donc avec ma Grand-Mère Mathilde, une très brave femme, dévouée, affectueuse, aimée de tout le voisinage. Je venais d’avoir quinze ans, et j’étais amoureux de France. Dieu qu’elle était belle ! Le Dimanche, à la Messe, avec son col blanc bien amidonné et son petit fichu bleu, posé sur ses longues nattes blondes, on aurait dit une Madone ! C’est d’ailleurs, pour cette raison, que le Curé de la Paroisse l’avait choisie depuis les deux derniers Noëls, afin de représenter la Vierge Marie pour sa Crèche vivante, à l’occasion de la Messe de Minuit. Et moi, je tenais le rôle de Joseph. C’est ainsi que nous avions fait connaissance, France et moi. Jusqu’à cette époque, je ne m’étais guère intéressé aux filles, si ce n’est pour les canarder à coups de marrons, à l’automne, ou les faire « couiner », en leur tirant les cheveux. Mais France…c’était une déesse…ma divinité à moi. Je sais, c’est païen ce que je dis…mais c’est comme ça ! Pour que sa Crèche vivante soit parfaite, le prêtre nous avait fait venir à l’église, plusieurs fois de suite après l’école, afin de soigner les détails. Un soir, j’avais eu l’audace d’adresser la parole à France, et lui avais demandé si la personne qui l’accompagnait, était sa Maman. Elle me répondit dans un sourire triste, que c’était sa gouvernante. Je découvris ainsi, que l’on pouvait avoir une personne à son service, pour soi tout seul ! Par la suite, j’appris que son père, un important architecte, était souvent absent, parti sur des chantiers, et que sa mère, une pianiste reconnue, se produisait à travers le monde. France se sentait souvent un peu abandonnée, dans sa belle villa. Cette similitude – des parents absents – nous a sans doute rapprochés. Et nous avons pris l’habitude de nous rencontrer en cachette. En ce temps là, nous n’étions que des enfants, heureux de berner les grandes personnes. Nous avions notre point de rendez-vous secret : c’était, non loin du moulin à eau, une sorte de petite grotte au sol sablonneux, où nous venions nous asseoir, loin des yeux et des oreilles des gens du pays. Car il fallait éviter les commérages. Et nous bavardions à bâtons rompus, nous confiant nos petits secrets, nos chagrins, nos espoirs ; nous envisagions l’avenir, nos études, nos futures professions. France, dans sa maison solitaire, lisait beaucoup. C’est elle qui me fit découvrir les beaux textes, la poésie, les grands écrivains. Un jour, l’œil pétillant, elle me parla de Roméo et Juliette. Ce fut une révélation pour nous ! Comme nous, deux adolescents devaient se cacher de tous. Certes, nos familles respectives ne se connaissaient pas, mais nous avions bien conscience qu’elles s’opposeraient à notre union future…Car le temps avait passé, nous avions grandi, mûri, et notre belle amitié s’était muée en amour. Oh, un amour bien sage. France m’avait parfois interrogé pour savoir qui étaient mes parents, ce qu’ils faisaient dans la vie. Un peu gêné, j’avais menti, racontant que ma mère était veuve. Or, ce fantôme de père, commençait à m’intriguer. Ma Grand-Mère s’était toujours montrée très évasive à ce sujet. Un soir, avide de savoir, je l’avais poussée dans ses derniers retranchements, lui déclarant tout de go que j’étais en âge de connaître la vérité. C’est en pleurs qu’elle conta l’histoire de ma naissance. Pendant l’occupation, ma mère était tombée amoureuse d’un soldat allemand. J’étais le fruit de leurs amours. J’avais souvent entendu parler de ces femmes coupables. Ainsi donc, ma propre mère faisait partie de ces chiennes qui s’étaient offertes à l’ennemi et que l’on avait tondues à la libération ! Horreur ! J’étais un sale bâtard ! J’étais le fils d’un boche ! J’étais la TACHE ! Et dire que le père de France avait été durant la guerre un des grands Chefs de la Résistance ! Après cette révélation, je partis comme un fou à travers champs, hurlant mon chagrin, invectivant le ciel. Mon amour pour France était définitivement sans espoir. J’étais anéanti Et pourtant, je n’étais qu’une pauvre victime ! Je n’en voulais pas à ma mère. Elle aussi, d’une certaine façon avait été victime. Victime d’un certain romantisme qui lui avait fait croire que la paix entre les peuples pouvait exister. Elle avait bravé les bons principes pour pactiser avec l’ennemi, tout comme moi, enfant de la basse classe, avais frayé avec la Haute Société. Ma décision fut vite prise : je ne pouvais rester dans cette ville. Revoir France, sans pouvoir l’approcher, devenait impossible, trop douloureux. J’allais partir, m’engager comme mousse et voir du pays. J’étais déterminé. L’éloignement apporterait peut-être le calme dans mon cœur. Je rédigeais une longue et pathétique lettre pour France, préparais mon balluchon, embrassais ma Grand-Mère et partis vers la mer.