SAMEDI
6 octobre 2018
de 14h00 à 19h00
dans le cadre du cycle
"Vives incitations"
Animation : Régis MOULU
Thème :
Occasionner le "zéro distance" avec son lecteur / auditeur
Plusieurs procédés permettent de se rapprocher de son lecteur, telles une émotion contagieuse et envahissante, une sympathie facilitant l'identification, une proximité frôlant l'intimisme. L'intérêt serait alors de faire vivre à l'Autre des sensations, et pourquoi pas, même intenses... et plus largement de le bouleverser, comme pour mieux le ramener à sa cause. Aussi, nous amuserons-nous à expérimenter ce nouveau thème...
Remarque
: au-delà de la contrainte formelle
(thème), ce sujet a été énoncé en début de séance : créer un contexte de beauté et de merveille qui génèrera chez l'acteur de votre texte l'envie de lancer un cri de bonheur qui ne se déclenchera pas, sans quelque inquiétude. Par ailleurs, votre texte devra comporter ces 10 mots : bassine, bec, bœuf, brique, condoléance(s), diablesse, dicter, inépuisable, pistache, voûte.
 Pour stimuler et renforcer l'écriture et les idées
de chacun, un support développant notamment la roue des émotions et la façon de mener un point de vue a été distribué en ouverture de session.
Pour stimuler et renforcer l'écriture et les idées
de chacun, un support développant notamment la roue des émotions et la façon de mener un point de vue a été distribué en ouverture de session.
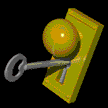
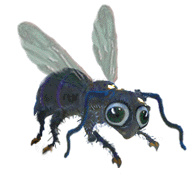


Ci-après
quelques textes produits durant la séance, notamment (dans l'ordre):
- "Condoléances" de Janine BURGAT
- "Mon lieu, mon antre" de Caroline DALMASSO
- "Départ" de Nadine CHEVALLIER
- "Peindre sa vie" de Christiane FAURIE
- "Promotion" de Janine NOWAK
- "Charles est mort" d'Edith SEVRIN
- "Rangez vos satellites" de Régis MOULU
"Condoléances" de Janine BURGAT
- Il y aura du boeuf en sauce et de la glace à la pistache. Tout ce que tu aimes. Approche la bassine.
Gégé et moi nous nous apprêtons pour les festivités à venir. Gégé a huit ans et moi dix.
La maisonnée s'affaire aux fourneaux au rez de chaussée. Et nous deux, on se débrouille. Pour une fois bien tranquilles.
Chez mémé, la toilette est sommaire. Un petit lavabo pour le haut ; que de l'eau froide. Et une grande bassine pour le bas et les pieds.
Depuis l'aube, ce matin, la cuisine prend toutes les secondes de mémé. Sinon elle superviserait notre toilette de chat.
Mémé a préparé nos jupes écossaises et nos chemisiers blancs sur le lit à côté, et puis une brosse à cheveux et deux serre-têtes en velours noir.
La bassine mousse comme un champignon atomique et la mousse blanche recouvre les jambes maigrelettes de ma petite soeur. Ca sent bon le propre. On nous a laissé la grosse brique de savon, celle que mémé utilise pour sa lessive au lavoir du hameau.
- Avec un gros savon, on est sûr que les diablesses seront bien présentables, a dit mémé.
Je n'aime pas quand mémé nous appelle "les diablesses". Le diable c'est notre peur, la nuit, le soir avant de s'endormir. Ou bien quand on entend pépé ronfler dans la chambre à côté. Là c'est le diable. Alors pourquoi s'invite-t-il dans la bouche de mémé quand elle parle de nous ? J'ose pas lui demander. Il y a tant de questions sans réponse !
Gégé frotte ses jambes avec acharnement pour bien faire comme mémé nous a dit. Un bon petit soldat Gégé. Certains jours, moi, je lui tire la langue à mémé quand elle ne peut pas me voir bien sûr.
Ce matin, elle nous a consigné dans le coin de chambre installé en salle d'eau comme elle appelle lavabo, broc, bassine, gants et serviette de bain. Et les serviettes, moi, je les trouve trop petites. Il y a les mêmes à côté de l'évier en pierre dans la cuisine pour les mains. De bain, ces serviettes là n'ont même pas le nom.
- Vous avez fini là-haut ?
La voix de mémé au bas de l'escalier déchire nos rires.
- Pépé doit se raser, alors dépêchez-vous.
Regarder pépé se raser est un ravissement inépuisable. D'ordinaire il s'installe dans la cour le dimanche matin. Il pose une petite glace en équilibre sur le pommeau de la fenêtre et taille au coupe-chou les poils de sa barbe comme une faucheuse l'herbe haute.
Le coupe-chou va et vient du visage à la bassine d'eau posée devant et la mousse grossit par petits monticules blancs puis gris. Ca sent la lavande et le savon à raser frais. Il a le visage tout cartonné. Il le tire, le relâche, le malaxe, mais sourit tout de même. C'est un des rares moments où il sourit vraiment. La lame crisse et pépé ronronne. Gégé et moi, en général, on est assises sur le muret avant la cave voutée qui sert de garde-manger à la maisonnée. Il a du plaisir, on en a aussi. Alors, il nous regarde fixement et c'est un moment bizarre mais que j'aime bien.
Gégé est habillée, peignée. Elle se tortille sur place pendant que j'enfile ma jupe.
- Pourquoi on va tous manger ensemble ? demande ma petite soeur.
- Ils vont tous venir manger après l'enterrement.
- L'enterrement de qui ?
- Je suis pas sûre mais je crois que c'est l'oncle Charles, le frère de mémé.
- Celui qui a un bec de lapin ?
- Un bec de lièvre ! Mais il l'a plus puisqu'il est mort !
- Pourquoi on dit un bec de lièvre ? demande Gégé
- Ca c'est une bonne question.
J'avais du dégoût quand il me regardait. Je m'arrangeais toujours pour ne pas l'embrasser. Même la bouche fermée, sa lèvre relevée découvrait une dent. On aurait dit comme un oeil dans sa bouche.
Parfois, quand mémé nous voit faire des grimaces, elle lance à la volée.
- Attention, les grimaces elles restent, regardez l'oncle Charles.
Ca nous dicte illico un rétablissement brutal du visage.
- Gégé, faudra bien se tenir parce qu'il va y avoir des condoléances.
- C'est quoi ? dit Gégé les yeux ronds.
- C'est ce qu'ils disent en s'embrassant au cimetière. Au mariage, ils disent "félicitations" et ils s'embrassent. Aux enterrement, c'est "condoléances" et ils s'embrassent aussi. C'est comme ça.
- Oui, mais là, ils vont manger, les condoléances seront finies.
- Manger et boire. J'ai vu Pépé remplir un petit tonneau à la cave hier après midi.
C'est simple. Au mariage, ils boivent et ils dansent.
Aux enterrements, ils boivent et ils parlent, c'est la différence.
- Alors moi, dit Gégé, j'aime bien les enterrements aussi. S'ils boivent après, ils rigolent et nous on les regarde faire.
Gégé a raison. En plus, on ne sera plus obligées de regarder le bec de lièvre de l'oncle Charles.
Quand la maisonnée est réunie, mémé est heureuse et nous présente à tous ceux qui ne nous connaissent pas encore. Au moins ce jour là, on dirait qu'elle est fière de nous.
- Descendez vite, les premiers arrivent !
Mémé semble bien excitée. Alors on dégringole dans l'escalier. Elle nous jette un coup d'oeil rapide.
- Tenez vous bien, dit elle, tout bas, c'est quand même un enterrement.
- Compris mémé, les enterrements c'est tout ce qu'on aime !
"Mon lieu, mon antre" de Caroline DALMASSO
Je suis debout, tous les sens en éveil. Il fait noir tout autour de moi et malgré cela je
ressens le besoin de fermer les yeux, comme pour mieux saisir tous les éprouvés de mon
être en cet instant précis.
Là, ça se passe là et maintenant.
Je sens mon corps dans cette forêt étrange, espace clos dont la voûte fait mon ciel. Je
sens l’air suivre le chemin de la vie jusqu’à soulever ma poitrine et faire battre mon coeur.
Boum boum, boum boum, boum boum… C’est le seul bruit que j’entends. Non, ce n’est
pas le bec d’un oiseau de nuit, cognant, fouillant, cherchant à attraper sa maigre pitance.
Non, c’est un bruit sourd, il vient de l’intérieur, il vient de moi, il est en moi, flux vital,
pulsation inépuisable qui m’accompagnera jusqu’au seuil de ma finitude.
Mes poils se hérissent. Il fait froid. L’air est glacé. Cela ne suffit pas à atténuer l’odeur acre
et tenace du lieu. Ce lieu que j’affectionne plus que tout autre, ce lieu où sont dictés mes
gestes, ce lieu où ma diablesse de vie prend tout son sens. Mon lieu, mon antre…
Oui, comme tous ici je suis voué à l’inexorable fin. Mais ce jour n’est pas arrivé. J’ai
encore tant à faire, tant à apprendre, tant à accomplir.
Comme le maçon face à son tas de briques avant de construire sa maison, comme le
peintre face à son modèle avant de l’immortaliser sur la toile, comme le poète face au vide
insoutenable de la feuille blanche avant que les mots ne jaillissent en un marquage faisant
taire le brouhaha incessant du monde et faisant advenir le silence libérateur. Oui, comme
tous les créateurs je suis face à mon oeuvre à venir.
Je grouille de pistes, je fourmille d’idées. En ma demeure intime est un microcosme fertile
et généreux. Non seulement je suis résolument vivant mais je suis fécond et fructueux. N’y
a t’il pas plus grande jouissance?
Mais mon oeuvre sera t’elle accueillie comme elle le mérite? Sera t’elle appréciée à sa
juste valeur? Oh misère! Tous ces gueux ignares, inconscients du Grand Oeuvre, ces
amateurs de malbouffe et adeptes de la restauration rapide sauront ils goûter mes qualités
d’artiste? Oui artiste, j’en suis un, j’ose le dire. Le mot « art » ne vient il pas de « ars » dont
le sens est « habilité à faire avec »? Et je suis habile, très habile…
Bon, c’est pas tout mais j’ai du boulot moi et puis ça commence à cailler dans cette
chambre froide. Allez, j’allume… J’ai mon tablier, les couteaux sont là, la bassine aussi et
les carcasses ont été livrées.
Condoléances veaux, vaches cochons, poulets, au menu aujourd’hui c’est boeuf en gelée
et terrine aux pistaches.
"Départ" de Nadine CHEVALLIER
Je ne ressens rien. Depuis une semaine, j'erre sans but, à la recherche de moi-même. Ce matin, Émilienne, ma femme, tourne en rond dans la cuisine. Ses yeux sont rougis de larmes séchées, elle ne me regarde pas.
Je la vois prendre une éponge, la mouiller dans la bassine sur l'évier, essuyer une tache imaginaire sur le coin de la table. Elle y laisse l’éponge, ouvre le placard, celui dont je n'ai pas pris le temps de graisser la porte qui grince sinistrement. Elle en sort le sachet de graines, elle a toujours raffolé des pistaches. Je me dis qu'elle va en grignoter quelques-unes malgré l'heure matinale. Non, elle le laisse sur la table, s'approche de la cage. Le canari n'a pas chanté ce matin, j'ai dû lui faire peur. Il donne de petits coups de bec sur les barreaux. Émilienne va-t-elle le laisser voler dans la cuisine comme chaque jour ? Non, elle touche à peine la cage du bout des doigts, va vers la fenêtre, l'ouvre et s'appuie un instant sur le rebord de briques. Elle jette un coup d’œil au ciel clair. Le soleil se lève à peine au-dessus des toits. La journée sera belle.
Quand Émilienne se retourne, je vois une larme glisser le long de sa joue droite. Elle l'essuie avec la manche de sa chemise de nuit.
Ma fille entre alors dans la cuisine, en pyjama, elle est pâle, les cheveux hirsutes. Elle prend sa mère dans ses bras et la serre contre elle. Je les laisse à leur étreinte.
Plus tard dans la matinée, je les retrouve. Elles sont au premier rang. La musique jaillit, le chant du chœur retentit sous la voûte de pierres. C'est beau. Je ressens une grande joie au milieu de cette foule où je reconnais tant d'amis. J'ai envie de m'envoler tout là-haut avec les notes, laisser la musique m'emporter et ne jamais redescendre vers les soucis terrestres.
Quand nous sortons, il est près de midi. Il fait chaud. Le cortège se met en marche. Nous allons devant. Une immense paix m'a envahi. L'air est clair comme après une pluie d'été, Les rues, les maisons ont une présence palpable, une réalité comme je n'en ai jamais éprouvée. Je me sens illimité, je suis cet érable, je suis ce lampadaire, je suis ce caillou, je suis même cette image de bœuf sur l'affiche au coin du mur. La vie est là.
Émilienne et notre fille marchent à petits pas. Émilienne est belle et élégante comme au jour de notre rencontre. J'éprouve pour elle le même amour. Je voudrais pouvoir la prendre dans mes bras mais … pourquoi me semble-t-elle soudain si étrangère ? Sa bonne éducation lui a toujours dicté une conduite un peu rigide, aujourd'hui, elle pleure en public, je ne la reconnais plus.
L'instant semble solennel. Nous nous sommes arrêtés au milieu d'un amas de bouquets multicolores. L’entêtante odeur des lys m'enivre. Les pétales des roses étincellent de vermeil sur les feuillages sombres. A nouveau m’étreint cette sensation de plénitude devant la beauté inépuisable de la vie qui se déploie ici. Un silence recueilli s'est posé sur l'assemblée.
Mais les gens se pressent autour d’Émilienne. Des paroles sont prononcées à mi-voix, que j'entends à peine «...condoléances...»
Émilienne et notre fille remercient. Je ne peux plus m'approcher.
Quel bel enterrement, pensé-je.
La vie est là et je n'en fais plus partie.
Avant d'être entraîné vers un ailleurs incertain, j'ai le temps d'apercevoir une jeune diablesse aux tresses rousses emportant une rose, volée sur ma tombe …
Dans un ultime éclair de conscience, je ris !
"Peindre sa vie" de Christiane FAURIE
Je rentre enfin après toutes ces années enfermé la bas au pied de cette montagne imposante, impériale et immuable.
Je n’ai connu qu’elle. A 50 ans passés, la mer m’est encore inconnue.
Je ne peux que l’imaginer la diablesse mais elle m’est essentielle.
Le Docteur Lambert me l’a répété : il faut expulser le poison en vous par la peinture ou l’écriture ; vous verrez, cela va espacer les crises. Il en va de la stabilisation de votre état et de votre retour chez vous.
Tout jeune déjà ma vie était peuplée des personnages fantastiques que je côtoyais avec plus ou moins de bonheur.
Il ne m’est jamais venu à l’esprit de les faire vivre au grand jour dans un journal intime.
Ma sœur y consacrait son temps libre avec délectation. J’imaginais ses basses pensées, ses désirs inassouvis placés sous le sceau du secret.
Elle le fermait à l’aide d’une petite clé recourbée comme un bec menaçant. Malheur à celui qui enfreindrait la loi du silence.
Je prenais un malin plaisir à lui dérober et le cacher dans la cuvette sous l’évier, non pour le lire, ça ne m’intéressait pas, mais pour entendre son hurlement résonner au bout du corridor.
A quoi pouvaient servir ces souvenirs honteux consignés et bouclés comme autant de terreurs d’enfants étouffées et de rage crachée sur la feuille.
Moi, je voyageais constamment entre le monde réel et celui que je construisais au gré de ma fantaisie. J’étais sans cesse dans la stupéfaction de mon être et la terreur de mes pensées.
Un beau jour, je me suis emparée de toiles mises à ma disposition par le Dr Lambert, grand collectionneur d’aquarelles.
Il en vend dans la région et a décidé que j’avais du talent ?
Son attention est inépuisable.
J’aime ce moment ou l’eau se mêle aux couleurs.
Mon univers est uniquement constitué de montagnes, alors je les peins inlassablement. Seules les couleurs se modifient. Les verts se heurtent tantôt menaçants aux sommets, tantôt en confiance sur les flancs.
Parfois, je suis débordée par un accès de colère. Le rouge carmin me dicte son besoin impératif d’expulser la rage du soleil couchant. Il vire au rouge brique quand le soir tombe sur les branches des cimes.
Un bœuf au loin crie sa détresse et je m’apaise.
Je recouvre alors de vert pistache le jeune noisetier à peine né.
La toile se pare peu à peu et il ne reste qu’un mince filet en bas comme un liseré de condoléances.
Vite, je plonge dans un mélange de bleu et mauve par distraction et un immense chagrin s’écoule dans les eaux profondes, comme une voûte céleste. Je suis si bien à cet instant.
Je sors alors à l’air libre pour donner ma toile au soleil et la laisser sécher et s’emparer des eaux colorées pour en faire une mer étale ou menaçante.
Je rentre à la maison. J’aperçois Maman assise sur mon fauteuil, indifférente, mon chat Mathys sur ses genoux.
Sa chevelure flamboyante emplit la pièce d’un halo de lumière. Mathys n’émet aucun ronronnement. Il ne lui fait pas ce cadeau, elle ne l’a jamais aimé.
Elle ne jette aucun regard sur mon tableau, indifférente à ce qui l’entoure.
Pourtant, elle m’a aimé. Elle chassait souvent Mathys de peur qu’il ne me griffe.
Personne n’a compris mon geste le jour où j’ai mis le feu à sa chevelure faisant d’elle une torche vivante, Mathys dans ses bras.
Je sais qu’ils ne sont plus vraiment là. Mais Maman vient tous les jours s’asseoir dans mon fauteuil avec Mathys. Je n’ai pas de remords, elle était si belle avec sa chevelure de feu. J’ai passé 10 ans de ma vie enfermé la bas, sans visites autres que celles du Dr Lambert.
Maman est d’accord, ça suffit.
Elle aime contempler, en ma compagnie, les montagnes exposées sur les murs et les fenêtres de sa maison.
Ma vie est déterminée par les couleurs que mes pinceaux volent à la palette.
Quand la rage me prend, le ciel menaçant envahit la feuille et dépasse le cadre pour se noyer dans une mer sombre et dangereuse dans laquelle je me baigne pour apaiser mon âme.
"Promotion" de Janine NOWAK
Voici seulement trois semaines que je suis au service de Madame. Quel changement pour moi qui, jusqu’alors, n’avais connu que la ferme de mes parents ! La besogne en milieu rural ne me rebutait pas. Je la faisais par habitude, sans me poser de questions, sans états d’âme. Levée avant le jour, couchée bien après la nuit tombée, très appliquée, j’accomplissais mes corvées, sans dégoût ni enthousiasme, mais toujours avec soin. Ma soumission était totale.
Ma mère, mettant au monde chaque année un nouvel enfant, il y eut bientôt trop de bouches à nourrir à la maison. C’est ainsi que petit à petit, je vis partir mes sœurs aînées, pour des destinations diverses. Certaines prirent le chemin des fabriques de la région. D’autres furent recrutées comme servantes dans de grandes et riches exploitations agricoles, qui employaient une importante domesticité.
Mon tour vint le jour même de mes quinze ans.
C’est le cœur serré par l’émotion et l’appréhension, que je partis, avec mon baluchon sur l’épaule, dans la charrette brinquebalante du Père Matthieu qui se rendait à la ville pour vendre quelques veaux. Je terminai le chemin à pied, jusqu’à la demeure de mon futur employeur.
J’eus l’impression de pénétrer dans une ruche. La maisonnée était en effervescence. Et je fus aussitôt happée par le tourbillon, car, dès mon arrivée, une femme à l’air sévère, m’amena d’autorité vers le poulailler. Il y avait urgence, car le lendemain, un repas de fête devait être organisé et les besoins en animaux de basse-cour étaient nombreux. Je passais donc de longs moments à tuer et plumer bon nombre de volatiles. J’étais habituée à cette besogne. Elle ne me répugnait pas et je ne redoutais pas les coups de bec.
Le soir, la femme au regard scrutateur, sembla apprécier la qualité de mon travail.
Je dormis cette nuit là comme une souche, fatiguée par le voyage et la tâche importante que j’avais ensuite accomplie, mais surtout remuée en dedans de moi-même par toutes ces émotions.
Le lendemain matin, aux aurores, je fus dirigée vers la cuisine. Et là, quel émerveillement ! C’était une somptueuse et vaste salle voûtée. Ce lieu m’apparaissait aussi splendide que devaient l’être les Palais des Contes de Fées de toutes les belles histoires qui avaient bercé mon enfance.
Pendus aux murs, des casseroles, louches, écumoires, bassines, en cuivre rutilant, flamboyaient, jetant des éclats roux. Deux énormes cuisinières, déjà allumées, attendaient l’arrivée de nombreuses marmites. Une table, qui me parut immense, était recouverte de légumes.
On me fit asseoir sur un banc, et la corvée débuta. Nous n’étions pas moins de quatre pour peler, éplucher, gratter, écosser, effeuiller, équeuter, ébarber, râper, débiter en petits tronçons, retirer des fils. Ce monceau de plantes potagères semblait inépuisable.
D’autres femmes s’activaient à préparer les plats de viandes. D’autres encore, se consacraient aux desserts. Je découvris à cette occasion, un petit fruit sec décortiqué, tout vert, portant le nom de pistache.
Quelle activité autour de moi ! J’en avais le vertige.
Arrivant d’un milieu plus que modeste, je n’avais toujours connu que de frugaux et monotones repas. Aussi, étais-je totalement éblouie par la qualité, la quantité et la variété de tous ces préparatifs.
M’enhardissant, je demandais à ma voisine la plus proche, pour combien de convives ce repas était préparé. « Oh – me dit-elle – ce soir, il n’y aura que douze personnes à table ».
Douze personnes ! J’étais stupéfaite et rétorquais : « Douze personnes seulement et toute cette nourriture ? Monsieur est donc bien riche ? ». C’est dans un grand éclat de rire que l’on me répondit : « Ce n’est pas un Monsieur qui dirige ce domaine. C’est une Dame. Et elle est en effet très riche, car les livres qu’elle écrit se vendent bien. Elle est très célèbre, tu sais ».
Mais où avais-je mis les pieds ? La Dame portait le même prénom que mon père, et en plus, elle était écrivain, un métier normalement masculin.
Après tout, pourquoi m’inquiéter et me poser toutes ces questions ? Mes collègues de travail semblaient heureuses, on ne m’avait pas mal traitée, j’étais infiniment mieux alimentée, qu’à la maison et confortablement logée, avec un vrai lit douillet. Alors, pourquoi m’en faire ?
Nous n’avons pas travaillé en vain. Le repas fut très apprécié, nous dit-on.
Le jour suivant, je fis la connaissance de Madame. Elle vint en personne à l’office, pour distribuer ses compliments. J’étais toute émue, rouge de confusion, prenant ma part de louanges au passage.
C’est alors que Madame me repéra. Venant se planter devant moi, elle dit dans un sourire : « Qui est donc cette jolie diablesse aux boucles blondes ? ». On lui expliqua que j’étais arrivée deux jours plus tôt et que je ne rechignais pas à la tâche.
Mes joues déjà empourprées virèrent à la couleur brique.
Madame me considéra un certain temps, en silence. Puis elle s’éloigna sans mot dire.
Une semaine plus tard, on me conduisit, sans explication, dans les appartements de Madame. Aurais-je commis quelque sottise dont je n’avais pas conscience ? Je tremblais en pénétrant dans le logement. J’étais tellement troublée, que je ne remarquais même pas la beauté des lieux.
Constatant ma gène, Madame m’accueillit gentiment, et me dit : « Ma chère petite, abandonnez vite cette mine qu’il sied d’arborer à un enterrement, à l’heure des condoléances. Ecoutez-moi attentivement. Vous avez une jolie silhouette, un très gentil visage. Vous paraissez assez futée et vive, capable de prendre de bonnes initiatives, suffisamment du moins pour que l’on n’ait pas besoin de vous dicter constamment la conduite à tenir. Aussi, avec votre finesse, ce serait criminel de continuer à vous laisser accomplir un travail de bœuf, alors que vous seriez si bien à votre place ailleurs. J’ai justement besoin à l’heure actuelle, d’une avenante soubrette. Désormais, je vous charge de prendre soin de ma garde-robe, de ma toilette. Et par ailleurs, les jours de réception, vous servirez à table. Mes invités seront heureux de pouvoir profiter de votre charme juvénile ».
Aussitôt dit, aussitôt fait. Mes nouvelles fonctions débutèrent ce même jour.
Demain, un grandiose banquet est en préparation. Il y aura, m’a-t-on dit, des hommes de lettres (dont un russe), des poètes, des artistes, un peintre célèbre (à ce qu’il parait), dont le nom, que j’ai oublié, fait penser à la religion ; bref que des gens immensément connus.
C’est impressionnant. Je vais être dans mes petits souliers.
Quelle ascension pour moi dans l’échelle sociale en seulement quelques jours.
Le bonheur !
"Charles est mort" d'Edith SEVRIN
Charles est mort, je n'ai pas besoin de donner son nom de famille pour que l'on sache de qui je parle.
Nous sommes un petit groupe d'amis, réunis pour un apéritif avec quelques pistaches et autres gourmandises.
Jean a suivi à la télévision la commémoration faite à ce chanteur et nous parle de l'émotion dans les condoléances exprimées par les personnes publiques.
Pauline a découvert une chanson, "la piqûre". Elle a été écrite après la mort, par overdose, du fils de Charles. Nous ne la connaissons pas, elle nous la fait écouter ; quelle émotion!!! Cette diablesse, la drogue qui transporte pour un moment l'Homme dans une voûte céleste mais qui au fil du temps le casse.
Eric qui a écouté une émission retraçant la carrière de ce monument a été bassiné par les commentaires sur ces débuts difficiles, même si c'est grâce à cela, qu'en se battant bec et ongles il est arrivé à la notoriété avec la force d'un bœuf.
Nous avons envie de chanter, mais difficile de se mettre d'accord tant le répertoire de Charles est inépuisable. Nous aimons toutes ses chansons, car les paroles, sans nous dicter notre conduite, nous font réfléchir et voir les choses autrement, comme une maison qui se construit briques après briques.
Hervé qui ne s'était pas exprimé, nous propose de chanter "non, je n'ai rien oublié". Nous sommes tous d'accord, ne rien oublier de notre amitié, de nos souvenirs passés et de ceux à venir.
Heureux, nous nous applaudissons.
"Rangez vos satellites" de Régis MOULU, animateur de l'atelier
Soleil plein. Majestueux. Envahissant tout, comme un liquide. Panorama infini, large, à déplier comme un accordéon. Du vert en camaïeu inimaginable, insondable : étoiles de pissenlit, gerbes d'herbes, gribouillis de buisson, arbustes claironnants comme des adolescents, arbres dont la haute verticalité sert de râteau à des peuplades entières d'oiseaux et de singes : une constellation de becs jaunes et de culs rouges scintillait.
Josépha pâmait.
Quelle bassine ressourçante que cette clairière belle et bien invisible sur toute carte IGN.
Et la jeune femme se laissait aller à ses rêveries les plus fécondes. Ainsi un songe la prit dans ses bras fantasques : ne la voilà-t-elle pas en diablesse dresseuse de bœufs dans un cirque agricole où elle s'emploie à faire jongler ces grossiers bestiaux avec des briques multicolores comme s'ils jouaient à se lancer des pistaches.
Public heureux face à cet exercice terrible, jusqu'au moment où cette situation pleine de surprise et d'appréhension tourne au drame, toutes les condoléances furent adressées à la tribu de l'animal sacrifié… une carcasse de bovidé gisant sur le sable, abandonnée.
Sereine, Josépha était sereine, jamais son cœur n'avait été aussi bien placé au milieu du Grand Orchestre du Suave Plaisir, avec un "P" majuscule ! Un genre de grâce indéfinissable s'empara de ses jambes augustes tel un pédalé de mante religieuse au ralenti. Il y avait comme des voiliers qui sillonnaient et slalomaient dans les méandres de son vineux cerveau, belle crique où l'oursin de l'inquiétude avait disparu, comme pêché par le si précautionneux Dieu de l'Extase, avec un grand "E" !
Josépha ne savait plus qui elle était, un peu comme si elle pouvait être tout à la fois, selon son envie et avec une intensité élective.
Sans doute glougloutait-elle en d'inépuisables sons encore non répertoriés, oui l'infini la guettait, la happait sous sa voûte accueillante d'où un "welcome" clignotait étrangement. À ce stade, seuls ses désirs dictaient sa conduite. Elle avait le teint subtil des fantômes, ce derme de tissu, cette folle cotonnade qui sait si bien frayer avec les éléments. Être poreuse, voilà ce qu'elle ressentait de plus puissant en elle, à ce moment précis, et elle imaginait qu'elle était traversable comme une flamme, et qu'elle inviterait, malgré elle, chaque âme de passage à cette tentation de venir, comme ça, l'air de rien, entrer en son for intérieur comme on s'installe dans une chambre d'hôte. Un hôtel. Un gîte hospitalier. Un foyer-étape où de voit chacun s'y arrêter la consacrerait pleinement. dans son corps on aurait dit que se préparait une fête… D'un coup, une grenouille venimeuse s'approcha d'elle, éventa ses lèvres comme pour réinventer la parole relancée à son stade préhistorique, puis bondit sur son sac Hermès.
La roue des émotions ventila donc une bonne heure la jouvencelle : appréhension, dégoût, peur, acceptation, surprise, répugnance, agacement, colère, rage, ennui, vigilance, joie puis terreur colorèrent avantageusement et désavantageusement sa peau et ses pupilles innocentes, tant elle s'était imaginée être à la place du sac chevauché.
Elle eut à cet instant comme l'intuition que cette expérience faisait partie de l'éducation que se devait de recevoir toute nymphe, ainsi ne se crut-elle pas plus nymphe que toutes les nymphes, ainsi ne commença-t-elle pas à se libérer de ses vils vêtements.
L'assemblée des animaux de la forêt, jusque là discrète, le fut moins tant un nuage de têtes, telle une pluie de confettis apparut. Les yeux grands-ouverts de chaque espèce formaient un collier de perles bordélique, que dis-je, une bijouterie avec tout l'entrepôt.
Voir qu'elle est à ce point vue déclencha en elle un cri de bonheur rempli de voyelles insistantes, le râle de la chatte nymphomane ou même le brame du cerf violeur multirécidiviste ne sont rien à côté de cet opéra qui déferla sur la Terre, tel un déchirement d'azur qui eut de quoi faire court-circuiter tous les satellites stationnaires, y compris les plus soviétiques d'entre eux.